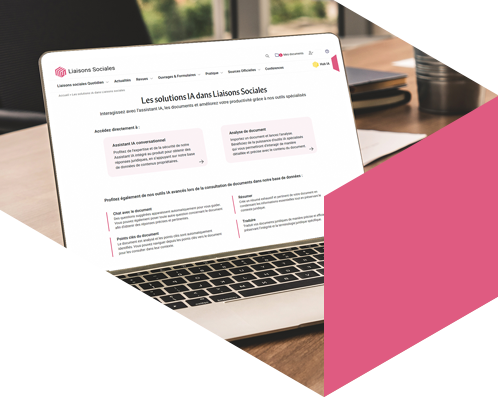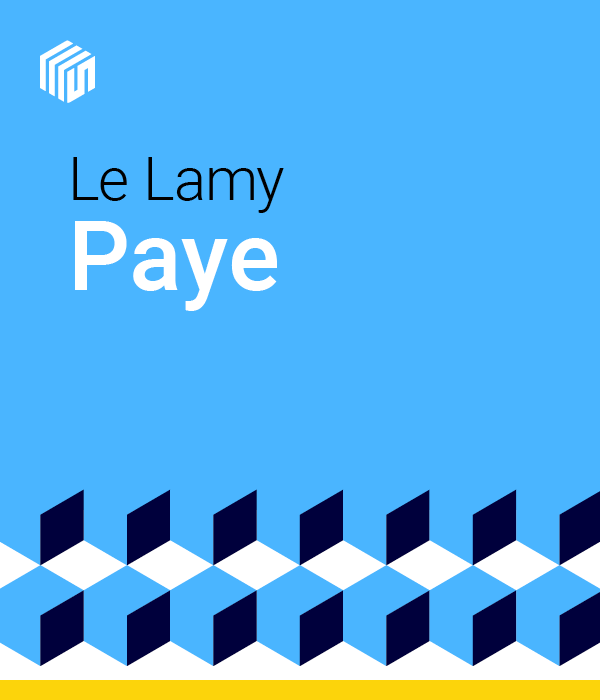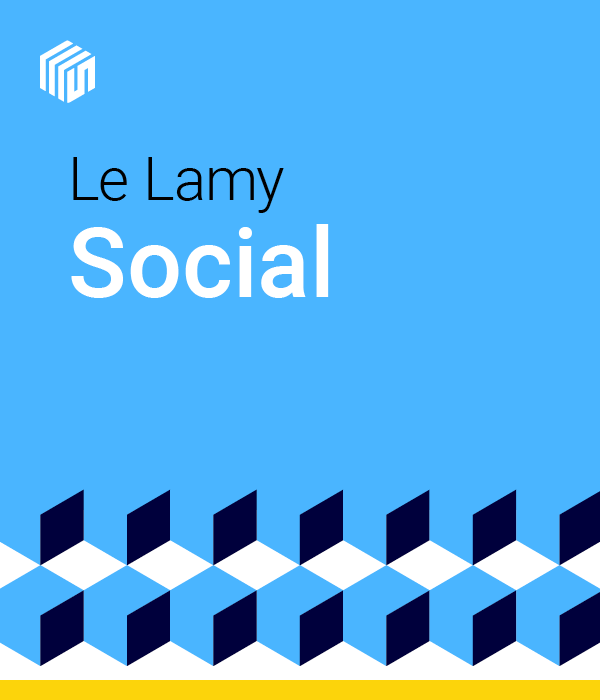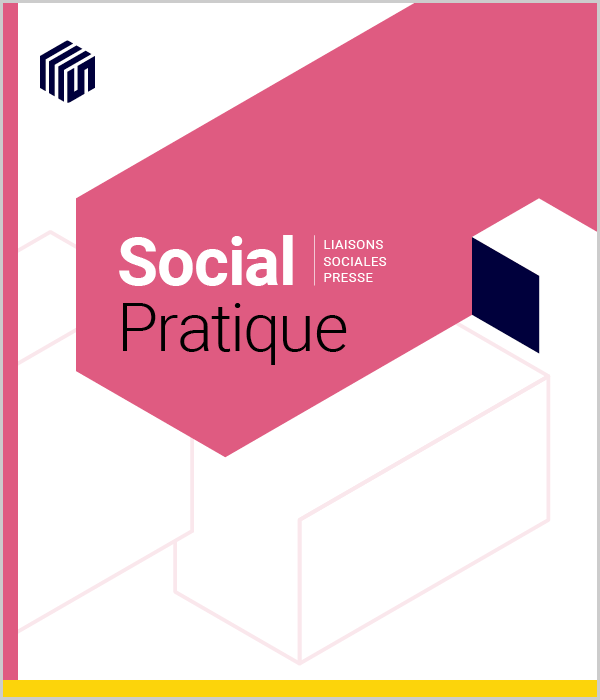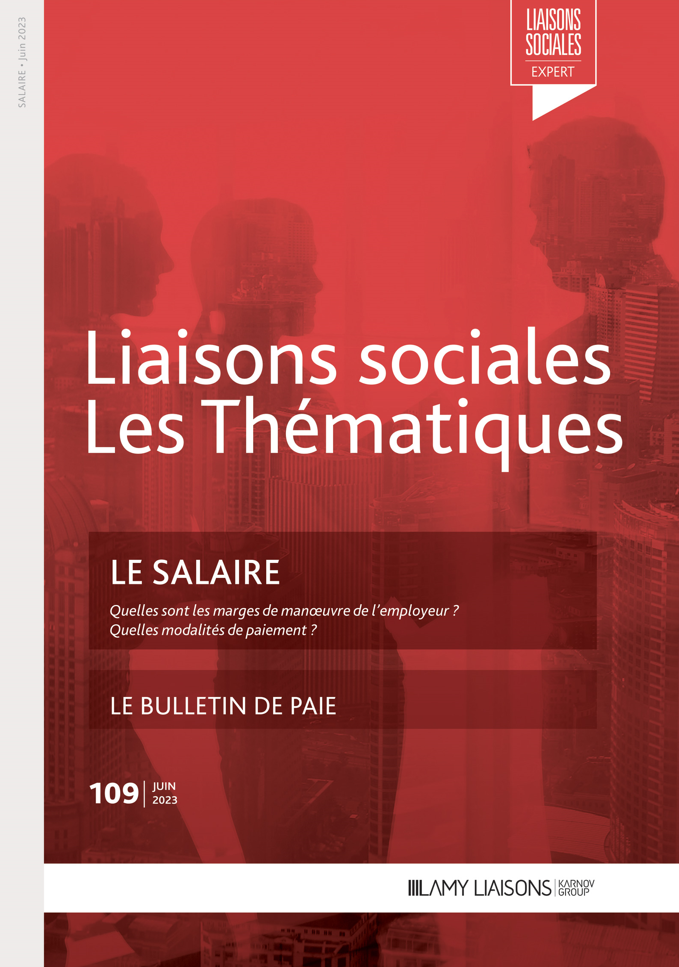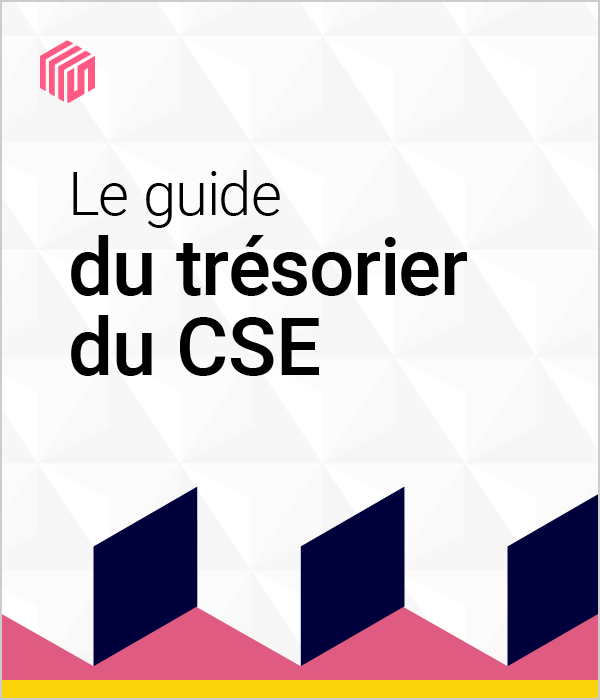Égalité salariale hommes-femmes : où en est la France en 2025 ?
L'égalité salariale entre les hommes et les femmes est un principe fondamental du droit du travail en France. Mais malgré un arsenal juridique important, les écarts de rémunération persistent. En 2024, les données de l'INSEE et de la DARES montrent un écart de rémunération global de 15 % entre les hommes et les femmes en France. Cet article vise à faire le point sur le cadre juridique, les évolutions récentes, les obligations des employeurs et les enjeux pour les ressources humaines.
- L'écart salarial global femmes-hommes en France reste à 22 % en 2025.
- À temps de travail équivalent, la différence s’élève à 14 %.
- À poste identique, l’écart tombe à 4 %.
- Un manque à gagner annuel de 6 090 € pour les femmes dans le privé.
- Les écarts sont plus marqués dans les postes à responsabilité et secteurs masculinisés.
- Le temps partiel et la répartition des professions expliquent, en partie, ces différences.
- L’Index égalité professionnelle, obligatoire depuis 2019 pour les entreprises de plus de 50 salariés, permet de mesurer et publier les écarts.
- 54 % des entreprises ont déclaré leur Index en 2025, mais la note élevée ne garantit pas toujours l’égalité réelle.
- La directive européenne sur la transparence des salaires doit être transposée d’ici juin 2026, mais l’égalité totale n’est pas attendue avant 2100 d’après certaines projections.
- Des audits réguliers, des grilles salariales transparentes et la formation des managers restent essentiels pour progresser.


- L’égalité salariale femmes-hommes : un enjeu mondial et national
- Le principe légal d’égalité salariale femmes-hommes
- Le cadre juridique de l’égalité salariale en France
- État des lieux de l’égalité salariale en 2025
- Les obligations de l’employeur : publication de l’index et mesures correctives
- L’index de l’égalité professionnelle : une avancée concrète ?
- Quelles actions concrètes pour les RH ?
- Les sanctions encourues par l’employeur en cas d’inégalité salariale
- Les enjeux pour les ressources humaines : audit, transparence et formation
- Les limites de l’index et les perspectives d’évolution
- Focus sur les cadres et les emplois qualifiés
- Les différences dans le monde et les comparaisons internationales
- Vers une égalité salariale réelle : quels leviers d’amélioration ?
L’égalité salariale femmes-hommes : un enjeu mondial et national
L’égalité salariale entre femmes et hommes demeure un enjeu central tant au niveau mondial que national, avec des différences de salaires persistantes dans la plupart des pays, y compris en France.
En moyenne, les femmes gagnent moins que les hommes pour un même volume de travail ou pour des emplois de valeur équivalente, ce qui alimente les inégalités de revenu tout au long de la vie professionnelle et au moment de la retraite.
La lecture des données internationales et nationales met en évidence la nécessité d’actions coordonnées pour réduire ces écarts, notamment dans les secteurs où les femmes sont sous-représentées ou moins bien rémunérées.
Le principe légal d’égalité salariale femmes-hommes
Le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue un fondement essentiel du droit du travail français. L’article L. 3221-2 du Code du travail dispose que « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Ce principe s’applique à l’ensemble des éléments composant la rémunération, qu’il s’agisse du salaire de base, des primes, des avantages en nature ou de tout autre accessoire de rémunération.
La notion de « travail de valeur égale » ne se limite pas à des postes strictement identiques. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités issues de l’expérience, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (C. trav., art. L. 3221-4). Ainsi, l’égalité de rémunération doit être assurée dès lors que les emplois comparés présentent des exigences équivalentes, même si les intitulés ou les missions diffèrent.
Ce principe d’égalité salariale s’inscrit dans une interdiction générale de toute discrimination fondée sur le sexe, tant en matière de rémunération que dans l’ensemble des aspects de la vie professionnelle (C. trav., art. L. 1132-1 et L. 1142-1). Il est complété par des obligations spécifiques pour les employeurs, notamment la négociation sur l’égalité professionnelle, la publication d’indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et la mise en œuvre de mesures correctives en cas de disparités constatées.
En cas de non-respect de ce principe, l’employeur s’expose à des sanctions civiles et pénales, ainsi qu’à l’obligation de verser un rappel de salaire au salarié lésé. L’égalité salariale femmes-hommes n’est donc pas seulement un objectif social, mais une obligation légale dont l’effectivité est garantie par un arsenal juridique renforcé au fil des années.
Le cadre juridique de l’égalité salariale en France
Les grands principes inscrits dans le Code du travail
L'article L3221-2 du Code du travail stipule que l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. Cette obligation interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. Une jurisprudence phare en la matière est l'arrêt de la Cour de cassation sociale du 6 juillet 2011, n° 09-42.710, qui a renforcé ce principe.
Pour approfondir la question de l’égalité salariale, il est également essentiel de comprendre comment le contrat de travail encadre les droits et obligations des parties, notamment en matière de rémunération et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Obligations spécifiques de l’employeur
Les employeurs ont plusieurs obligations spécifiques en matière d'égalité salariale. Ils doivent négocier sur l’égalité professionnelle (article L2242-1 du Code du travail) et mettre en place un rapport de situation comparée pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Depuis 2019, les entreprises de plus de 50 salariés doivent également publier un index de l’égalité professionnelle, qui mesure les écarts de rémunération, les augmentations, les promotions, le retour de congé maternité, etc.
En cas de non-publication ou si la note est inférieure à 75/100, des sanctions peuvent être appliquées.
État des lieux de l’égalité salariale en 2025
Données statistiques
En 2025, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes en France restent significatifs. L'écart global brut est d'environ 15 %, tandis que l'écart à poste équivalent varie entre 5 % et 9 %.
Ces écarts recouvrent des réalités différentes : l’écart global s’explique en partie par des facteurs structurels comme la concentration des femmes dans des métiers moins rémunérateurs, la prévalence du temps partiel ou encore la sous-représentation dans les fonctions de direction. À l’inverse, l’écart à poste équivalent met en évidence des situations de traitement différencié non justifié, potentiellement discriminatoires.
Depuis la transposition en droit français de la directive européenne 2023/970, les entreprises de plus de 100 salariés sont tenues de publier des informations sur les niveaux de rémunération moyens par sexe. Elles doivent justifier tout écart supérieur à 5 %. Ces obligations viennent compléter l’Index égalité femmes-hommes, en vigueur depuis 2019, qui impose aux entreprises de mesurer et corriger les écarts observés.
Au-delà des écarts ponctuels, les trajectoires salariales sur le long terme révèlent également des inégalités persistantes. Ainsi, une femme ayant un enfant subit en moyenne une baisse de revenus cumulés de 10 à 20 % sur les dix années suivant une naissance, un effet absent, voire inversé chez les hommes.
Les enfants et l’impact sur le revenu des femmes
La naissance d’enfants a un impact significatif sur le revenu des femmes, accentuant les inégalités salariales avec les hommes. En effet, les femmes interrompent plus fréquemment leur carrière ou réduisent leur volume de travail pour s’occuper des enfants, ce qui se traduit par une perte de salaire et une progression de carrière ralentie. Cette situation est moins marquée chez les hommes, qui continuent souvent à percevoir un salaire moyen plus élevé au cours de leur vie professionnelle, même après la naissance d’enfants.
Les différences selon l’âge, le niveau de qualification et le secteur d’activité
Les écarts de salaires entre femmes et hommes varient selon l’âge, le niveau de qualification et le secteur d’activité. Les différences sont souvent plus marquées chez les cadres et dans les emplois qualifiés, où les hommes gagnent en moyenne plus d’euros que les femmes.
Dans les services et certains secteurs industriels, les inégalités salariales persistent, tandis que dans d’autres secteurs, comme la fonction publique, les écarts sont moindres. L’âge joue également un rôle, les inégalités ayant tendance à s’accroître au fil de la carrière.
Focus secteur privé vs. secteur public
Dans le secteur public, les écarts de rémunération sont plus faibles mais persistent, notamment dans les corps techniques ou de commandement. L’existence de grilles salariales plus normées contribue à réduire les disparités.
Dans le secteur privé, les inégalités sont plus marquées, particulièrement dans les fonctions commerciales, techniques et de direction, où les négociations individuelles et la faible transparence jouent un rôle central.
Des écarts importants sont constatés dans des secteurs historiquement masculinisés tels que l’industrie ou les technologies.
Cas RH concret : comparaison de deux profils équivalents
Un audit de la politique de rémunération révèle l’absence de grille référentielle, une négociation à l’embauche déséquilibrée et un manque de revalorisation systématique.
Ce cas illustre la nécessité, pour les entreprises, de mettre en place des outils de contrôle comme les audits RH automatisés ou des .
Les obligations de l’employeur : publication de l’index et mesures correctives
Les employeurs ont l’obligation de publier chaque année un index de l’égalité professionnelle, qui mesure les écarts de salaires entre femmes et hommes selon plusieurs indicateurs, notamment la moyenne des salaires, la proportion de femmes et d’hommes dans chaque quartile de revenu, et la part des composantes variables.
En cas d’écarts injustifiés, l’employeur doit mettre en place des mesures correctives pour garantir l’égalité salariale. Ces obligations s’appliquent à toutes les entreprises d’au moins 50 salariés et visent à réduire les inégalités de salaires.
Méthodologie de calcul des écarts de salaires
La méthodologie de calcul des écarts de salaires repose sur la comparaison des salaires moyens en euros entre femmes et hommes, par catégorie d’emplois, niveau de qualification, âge et volume de travail.
Les indicateurs incluent :
- l’écart de salaire brut,
- l’écart sur les composantes variables,
- la proportion de femmes et d’hommes dans chaque quartile de revenu,
- et la ventilation par secteur d’activité.
Cette lecture fine permet d’identifier les sources d’inégalités et d’orienter les actions correctives.
L’index de l’égalité professionnelle : une avancée concrète ?
Présentation de l’outil
L'index de l’égalité professionnelle a pour objectif de mesurer et corriger les écarts de rémunération. Il est calculé à partir de plusieurs indicateurs et doit être publié chaque année.
Instauré par la loi Avenir professionnel de 2018 (articles L1142-8 à L1142-10 du Code du travail), il s’applique à toutes les entreprises de plus de 50 salariés.
L’index de l’égalité professsionnelle repose sur cinq indicateurs obligatoires :
- l’écart de rémunération femmes-hommes,
- les écarts d’augmentations individuelles,
- les promotions,
- les augmentations au retour de congé maternité,
- et la représentation des femmes parmi les plus hautes rémunérations.
Cependant, plusieurs limites méthodologiques peuvent nuire à sa portée : certains indicateurs ne sont pas calculés en cas d’effectifs insuffisants, les moyennes peuvent lisser des écarts importants à niveau égal, et des marges d’interprétation existent dans la sélection des données à déclarer.
Dans la pratique, les services RH rencontrent également des difficultés de mise en œuvre : absence de référentiels de postes précis, faible maîtrise des outils statistiques, et résistances internes à la transparence salariale. Ces freins nuisent à la fiabilité de certains résultats publiés.
Résultats observés depuis sa mise en place
Depuis sa mise en place, le taux de conformité des entreprises a augmenté. Cependant, l'efficacité de l'Index est relative : certaines entreprises atteignent des notes élevées sans garantir une égalité réelle.
L’index d’égalité professionnelle tend parfois à servir d’outil de communication institutionnelle, sans véritable transformation des pratiques. Ce phénomène de "signal" réputationnel soulève la question de la sincérité des engagements déclarés.
Étude de cas : entreprise notée 85/100 à l’Index mais poursuivie pour discrimination salariale
Quelles actions concrètes pour les RH ?
Auditer régulièrement les écarts de rémunération
Les RH doivent auditer régulièrement les écarts de rémunération en utilisant des méthodes statistiques comme l’analyse de régression. Cette méthode permet de comparer des situations équivalentes en tenant compte de variables comme l’ancienneté, le niveau de poste ou le périmètre de responsabilités. Pour garantir la fiabilité de l’audit, il est essentiel d’utiliser une méthodologie claire, traçable et reproductible.
L’identification des écarts injustifiés doit reposer sur des données fiables, bien catégorisées, issues des outils SIRH ou paie. Des outils RH tels que Talentsoft et Lucca peuvent être utilisés pour faciliter cette tâche, notamment en croisant les données de rémunération et de parcours professionnel.
Certaines organisations vont plus loin en utilisant des modèles prédictifs pour anticiper les risques d’écarts dès les décisions d’embauche ou d’évolution interne. Ces dispositifs permettent de passer d’une logique correctrice à une démarche préventive.
Mettre en place des grilles salariales transparentes
Il est essentiel de mettre en place des grilles salariales transparentes, basées sur des critères objectifs de rémunération tels que :
- le niveau de responsabilité,
- les compétences mobilisées,
- l’ancienneté
- ou le degré d’autonomie.
La communication interne et le dialogue social sont également importants : ces grilles doivent être accessibles, compréhensibles et exploitées concrètement lors des revues salariales ou des entretiens annuels. Leur existence ne suffit pas ; leur usage effectif est une condition clé de leur efficacité.
Sensibiliser et former les managers
Les managers doivent être sensibilisés et formés pour éviter les biais inconscients. Toutefois, au-delà de la dimension individuelle, il est également nécessaire de les former au repérage des biais systémiques, tels que les effets de reproduction dans les promotions ou les affectations genrées. Les enjeux d’égalité doivent être intégrés dans les entretiens annuels et les processus d’évaluation. À terme, l’implication active sur ces sujets pourrait constituer un indicateur de performance managériale.
Les sanctions encourues par l’employeur en cas d’inégalité salariale
Les salariés peuvent agir individuellement devant le conseil de prud’hommes ou engager une action de groupe depuis 2016 (loi J21).
Les entreprises non conformes à l'index peuvent être sanctionnées par une amende allant jusqu’à 1 % de la masse salariale. Toutefois, cette sanction reste peu appliquée faute de contrôles systématiques. L'efficacité réelle de cette mesure dépend donc du renforcement des inspections.
La jurisprudence récente inclut des décisions comme celle de la Cour de cassation sociale du 6 octobre 2021, n° 19-21.534, qui a condamné un employeur n’ayant pas justifié un écart de salaire.
Les enjeux pour les ressources humaines : audit, transparence et formation
Pour les ressources humaines, l’égalité salariale implique :
- la mise en place d’audits réguliers des salaires,
- la transparence sur les grilles de rémunération
- et la formation des managers à la non-discrimination.
L’analyse des différences de salaires entre femmes et hommes, la lecture des indicateurs et la communication des résultats sont essentielles pour garantir l’équité et prévenir les inégalités, notamment dans les emplois qualifiés et les postes de cadres.
Les limites de l’index et les perspectives d’évolution
L’index de l’égalité salariale présente certaines limites, notamment dans la prise en compte des différences de volume de travail, des parcours professionnels et des spécificités sectorielles. Les perspectives d’évolution incluent un élargissement des indicateurs, une meilleure prise en compte des emplois à temps partiel et des composantes variables du salaire, ainsi qu’une harmonisation des méthodes de calcul au niveau européen et international.
Focus sur les cadres et les emplois qualifiés
Chez les cadres et dans les emplois qualifiés, les écarts de salaires entre femmes et hommes restent importants, malgré une progression du niveau de qualification des femmes. Les hommes continuent de gagner en moyenne plus d’euros, notamment en raison d’un accès inégal aux postes à responsabilité et aux composantes variables du revenu. La lecture des données met en évidence la nécessité de politiques spécifiques pour favoriser l’égalité salariale dans ces catégories.
Les différences dans le monde et les comparaisons internationales
Les inégalités de salaires entre femmes et hommes sont un phénomène mondial, avec des différences marquées selon les pays, le volume d’emplois qualifiés occupés par les femmes, et les politiques publiques en faveur de l’égalité. Les comparaisons internationales montrent que certains pays ont réduit l’écart de salaire moyen grâce à des mesures volontaristes, tandis que d’autres accusent un retard important. La figure de l’égalité salariale reste donc un objectif à atteindre dans de nombreux secteurs et régions du monde.
Vers une égalité salariale réelle : quels leviers d’amélioration ?
Il est proposé de rendre les index plus exigeants et de renforcer les contrôles par l’inspection du travail.
Les bonnes pratiques incluent :
- le mentorat et l'accompagnement des femmes vers les postes à responsabilité,
- le suivi annuel des promotions et augmentations par sexe.
Malgré les progrès réalisés, des défis persistent en matière d'égalité salariale. L’égalité salariale est une obligation légale, mais aussi une exigence éthique et stratégique pour les ressources humaines. Les employeurs et les professionnels RH doivent auditer, corriger et sensibiliser pour atteindre une véritable égalité salariale.