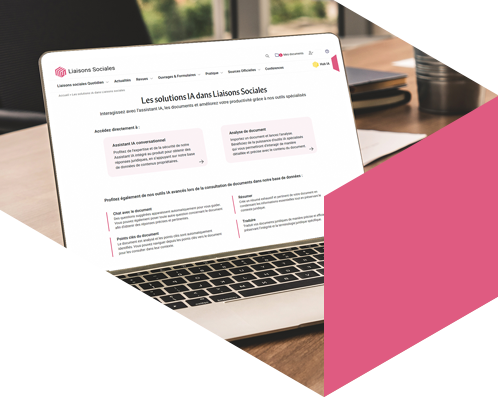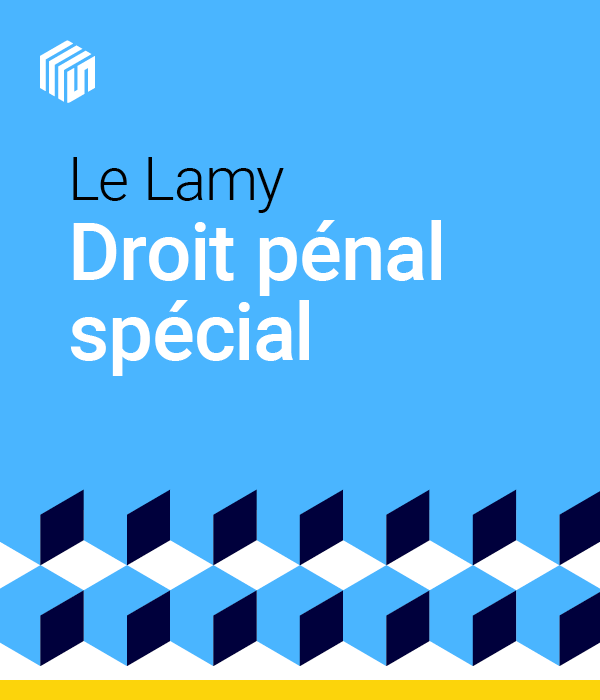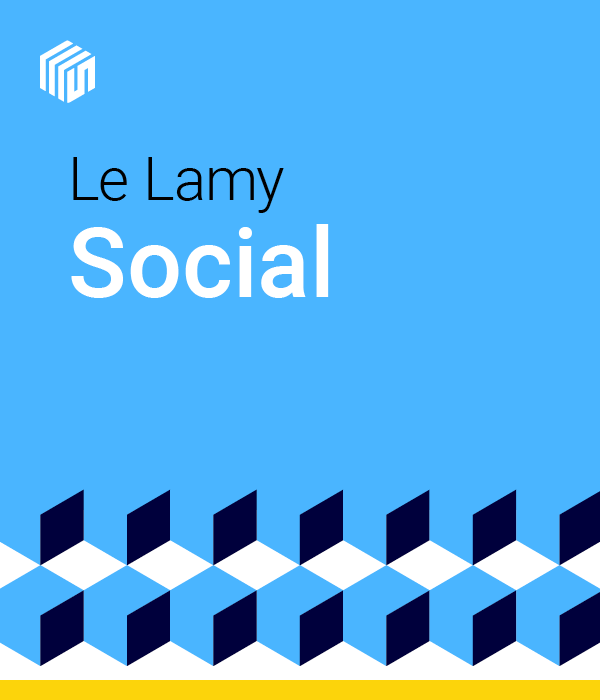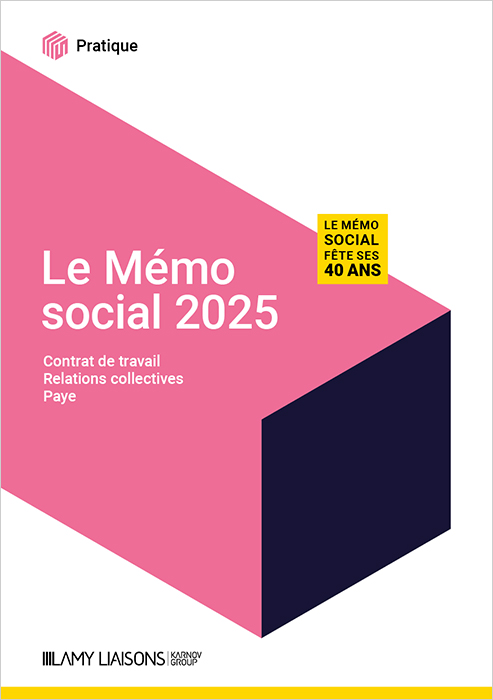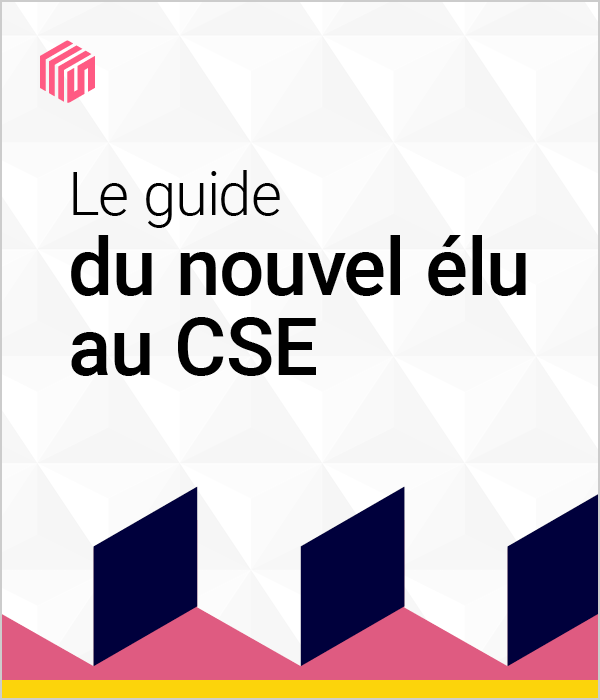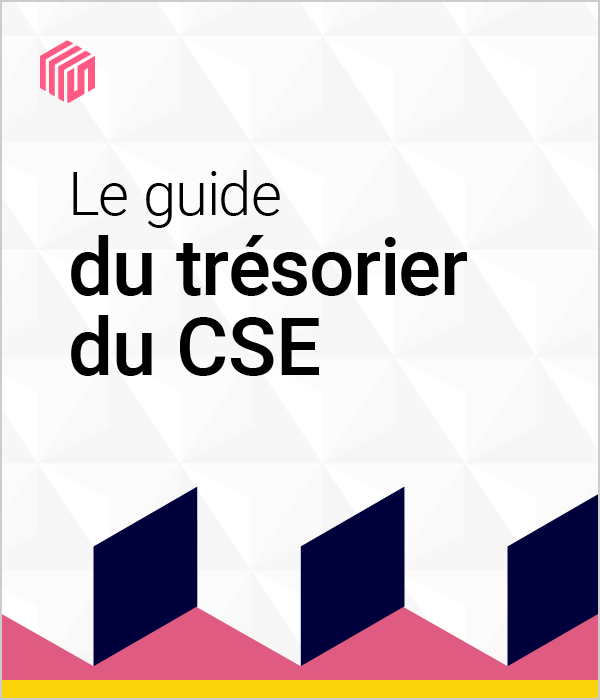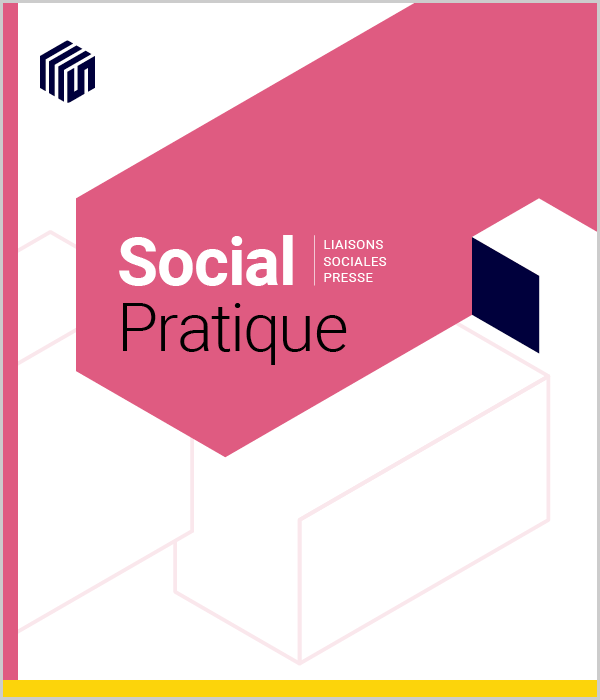Les atteintes à l'honneur et à la réputation en entreprise
En entreprise, une atteinte à l'honneur peut prendre la forme de propositions diffamatoires, rumeurs ou injures. Encadrée par la loi de 1881 et le droit pénal spécial , cette infraction peut entraîner des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales, même sans publication publique.
- Une atteinte à l’honneur ou à la réputation en entreprise peut relever de la diffamation, de l’injure ou du dénigrement.
- Ces faits peuvent engager la responsabilité disciplinaire, civile et pénale de leur auteur.
- Il est possible de porter plainte, sous conditions strictes (ex. : 3 mois pour diffamation publique).
- L’employeur a un devoir de protection envers ses salariés (obligation de sécurité et risques psychosociaux).
- Des preuves concrètes sont nécessaires (mails, témoignages, captures d’écran etc.).
- Plusieurs voies de recours existent : CSE, inspection du travail, conseil de prud’hommes, tribunal correctionnel.


- Qu’entend-on par atteinte à l’honneur et à la réputation en entreprise ?
- Quelles sont les formes d’atteintes à l’honneur en entreprise ?
- Quelles sont les conséquences juridiques de ces atteintes ?
- Que faire en cas d’atteinte à l’honneur ou à la réputation au travail ?
- Comment repérer et collecter les preuves d’une atteintev?
- Prévenir les atteintes à la réputation
- Le rôle de l’employeur face à ces situations
- À retenir – Checklist pratique
- FAQ sur les atteintes à la réputation au travail
Qu’entend-on par atteinte à l’honneur et à la réputation en entreprise ?
L’atteinte à l’honneur en milieu professionnel recouvre plusieurs notions juridiques précises.
Trois qualifications principales permettent de l’identifier : la diffamation, l’injure et le dénigrement.
Définition juridique : injure, diffamation, dénigrement
En droit français, ces notions sont encadrées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- La diffamation est définie comme l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, même si ce fait est allégué sous forme dubitative. Cette infraction est punie par l’article 29 de ladite loi, et peut être publique ou non publique.
- L’injure correspond à toute expression outrageante, terme de mépris ou invective ne contenant l’imputation d’aucun fait, visant une personne ou un groupe de personnes.
- Le dénigrement, quant à lui, relève du droit civil et concerne des propos visant à discréditer un salarié, un produit ou une entreprise, sans nécessairement porter atteinte à une personne nommée.
Ces trois qualifications peuvent coexister dans les faits, mais leur régime juridique et les procédures à suivre diffèrent.
Différence entre atteinte à l’honneur et harcèlement moral
Il ne faut pas confondre le harcèlement moral et la réputation professionnelle, bien que les deux puissent être affectés simultanément. Ces notions juridiques ont des implications différentes, tant sur le plan disciplinaire que pénal.
Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié (article L1152-1 du Code du travail).
Ainsi, une atteinte ponctuelle à l’honneur (ex. : propos diffamatoires isolés) n’est pas un harcèlement moral mais plusieurs atteintes répétées peuvent en constituer un élément matériel.
Exemples concrets en contexte professionnel
- Un supérieur accuse publiquement un salarié d’avoir falsifié un document sans preuve.
- Un collègue diffuse, sur le réseau interne ou par messagerie, des propos dégradants portant sur la vie privée d’un salarié.
- Un avis laissé sur une plateforme professionnelle (type Glassdoor ou LinkedIn) dénigre une personne nommément en la qualifiant de “manipulatrice” ou “incompétente”.
Quelles sont les formes d’atteintes à l’honneur en entreprise ?
Les atteintes à l’honneur en milieu professionnel prennent des formes variées, selon les canaux de diffusion, le type de propos tenus et la relation entre les personnes impliquées.
Diffamation entre collègues ou de la part d’un supérieur
La diffamation peut émaner aussi bien d’un collègue que d’un responsable hiérarchique. Elle prend la forme de propos précis imputant des faits graves sans preuve, susceptibles de nuire à la réputation d’un salarié.
Exemples
- Un manager accuse un salarié, devant d’autres collaborateurs, de falsifier ses horaires ou ses notes de frais, sans fondement.
- Un collègue affirme que tel agent a volé du matériel, alors qu’aucune procédure disciplinaire ni enquête ne l’atteste.
Rumeurs, moqueries, propos dégradants
Les rumeurs sur la vie privée d’un salarié, les moqueries répétées, ou les commentaires dévalorisants sur son physique, ses origines, ou ses choix personnels peuvent constituer une atteinte à l’honneur, voire une injure.
Ces propos, même diffusés dans un cadre non public (ex. : conversations informelles dans l’entreprise), peuvent engager la responsabilité de leur auteur. Ils contribuent également à un climat de travail délétère, susceptible d’être qualifié de harcèlement moral s’ils sont répétés.
Atteintes sur les réseaux sociaux professionnels
Les réseaux comme LinkedIn, Slack, Yammer ou même les groupes WhatsApp professionnels sont devenus des terrains propices à des publications pouvant nuire à la réputation d’un salarié ou d’un employeur.
Sont concernées :
- Les publications contenant des insinuations sur l’incompétence ou la malhonnêteté d’un salarié.
- Les captures de messages internes diffusées hors contexte.
- Les partages d’informations sensibles, même sans citer de nom, mais permettant d’identifier clairement la personne visée.
Dès lors qu’un préjudice moral est démontré et que la personne ou le groupe visé est identifiable, l’auteur peut être poursuivi, même si les propos ont été publiés hors du cadre professionnel.
Quelles sont les conséquences juridiques de ces atteintes ?
Qu’elles soient diffamatoires, injurieuses ou dénigrantes, les atteintes à l’honneur peuvent donner lieu à des sanctions de nature pénale, disciplinaire ou civile, selon leur gravité et leur contexte.
Sanctions pénales prévues par le Code pénal
Les atteintes à la réputation peuvent être pénalement punies, en vertu de la loi du 29 juillet 1881 et du Code pénal.
- Diffamation publique : jusqu’à 45 000 € d’amende (article 32)
- Diffamation à caractère discriminatoire : un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende
- Injure non publique : contravention de 38 € (article R621-2)
Les atteintes à la vie privée (article 9 du Code civil), la violation de correspondances ou la diffusion de messages privés peuvent également être poursuivies au titre du droit pénal spécial, dès lors qu’elles nuisent à la considération de la personne concernée.
Sanctions disciplinaires internes
En entreprise, ces comportements peuvent également faire l’objet de sanctions disciplinaires internes, prononcées par l’employeur.
En fonction de la gravité des faits, ces mesures peuvent aller :
- du blâme ou avertissement,
- à la mise à pied disciplinaire,
- voire au licenciement pour faute grave.
Pour approfondir ce point, consultez notre fiche dédiée à la sanction disciplinaire et à la mise à pied discplinaire.
L’auteur des propos ou comportements fautifs peut être un salarié, un supérieur hiérarchique, ou un représentant du personnel.
Réparation du préjudice moral (dommages et intérêts)
La victime d’une atteinte à son image, sa réputation ou sa dignité peut également agir en responsabilité civile. Il s’agit alors d’obtenir la réparation du préjudice moral, via une action devant le tribunal judiciaire.
Les dommages et intérêts accordés varient selon :
- la gravité des propos
- leur portée (publique ou interne)
- le caractère répété ou non de l’atteinte
- les conséquences professionnelles (isolement, mutation, refus de promotion…)
La Cour de cassation reconnaît régulièrement le préjudice d’image, même en l’absence de preuve d’un dommage matériel, dès lors qu’un trouble est établi dans les conditions d’exercice professionnel ou dans la vie privée.
Que faire en cas d’atteinte à l’honneur ou à la réputation au travail ?
Face à une atteinte à l’honneur ou à la réputation, plusieurs démarches sont possibles. Certaines relèvent du dialogue social ou de la médiation interne, d’autres s’inscrivent dans un cadre juridique plus formel.
Signaler les faits à l’employeur ou au CSE
Le premier réflexe doit être de documenter les faits (date, auteur, contenu, témoins éventuels) et de les signaler formellement :
- à son supérieur hiérarchique,
- à la direction des ressources humaines,
- ou au comité social et économique (CSE).
L’employeur est soumis à une obligation de sécurité (article L4121-1 du Code du travail), incluant la prévention des atteintes à la dignité. À ce titre, il doit enquêter, protéger la victime et, le cas échéant, sanctionner l’auteur de l’atteinte.
Ce signalement peut se faire par écrit (mail, courrier remis en main propre contre signature) et doit permettre à l’entreprise d’agir rapidement.
Recourir à une médiation ou alerter l’inspection du travail
Si le dialogue avec l’employeur est insuffisant ou impossible, deux options s’offrent à la victime :
- Recourir à un médiateur interne ou externe, notamment en cas de conflit interpersonnel non résolu. Certaines conventions collectives prévoient expressément ce recours.
- Alerter l’inspection du travail, qui dispose d’un pouvoir de constatation et peut formuler des recommandations ou orienter vers les juridictions compétentes.
Ces recours sont particulièrement adaptés lorsque les propos injurieux ou diffamatoires s’inscrivent dans un conflit hiérarchique ou lorsque la direction semble inerte.
Porter plainte et engager une action en justice
Si l’atteinte est caractérisée et qu’elle cause un préjudice sérieux, la victime peut décider de porter plainte :
- soit auprès du procureur de la République,
- soit par plainte avec constitution de partie civile,
- ou en saisissant directement le tribunal judiciaire pour une action en responsabilité civile.
Le délai de prescription varie :
- 3 mois pour une diffamation publique (loi de 1881),
- 1 an pour une action en réparation civile,
- 2 mois pour un recours disciplinaire.
Les plaintes pour diffamation doivent impérativement respecter les règles procédurales spécifiques : désignation précise des propos incriminés, indication de la date de publication, identité de l’auteur.
Comment repérer et collecter les preuves d’une atteinte ?
Le succès d’une plainte pour diffamation en entreprise ou injure au travail repose sur des éléments de preuve solides. Les preuves de diffamation envers un salarié doivent être concrètes, datées, et suffisamment précises pour caractériser les faits reprochés.
Les éléments les plus fréquents sont :
- Emails, captures de messages internes ou LinkedIn
- Témoignages écrits
- Rapports internes ou constats d’huissier
| Type de preuve | Validité | Conditions |
|---|---|---|
| Message électronique | Oui | Doit être daté, authentifiable |
| Témoignage | Oui | Doit nommer les faits et les situer |
| Capture de publication | Oui | Doit identifier l’auteur et le support |
Prévenir les atteintes à la réputation
Limiter les risques d’atteinte à l’honneur passe par une politique claire en matière de communication interne et de gestion des conflits. L’employeur peut formaliser des règles dans le règlement intérieur, encadrer les usages numériques et instaurer des procédures de signalement.
Organiser des sessions de sensibilisation aux propos diffamatoires ou injurieux et rappeler les obligations de respect mutuel renforce la prévention. Ces mesures participent à la responsabilité de l’employeur en matière de santé mentale et d’environnement de travail respectueux.
Le rôle de l’employeur face à ces situations
L’employeur est légalement tenu d’assurer la protection de la dignité de ses salariés. Cela relève de la responsabilité de l’employeur concernant l’atteinte à l’honneur, notamment dans le cadre de son obligation de prévention des risques psychosociaux.
Il est tenu de :
- enquêter sur tout signalement crédible,
- prendre les mesures conservatoires nécessaires,
- adapter le règlement intérieur pour encadrer les comportements diffamatoires.
Former les managers, rappeler la portée des propos écrits ou oraux et désigner un référent interne font partie des outils concrets à sa disposition. En cas d’inaction, sa responsabilité civile peut être engagée, notamment en cas de préjudice moral avéré.
À retenir – Checklist pratique
Avant d’engager une action pour atteinte à l’honneur en entreprise, vérifiez les éléments suivants :
- Le fait constitue-t-il une diffamation, une injure ou une atteinte à la vie privée ?
- L’auteur est-il identifié et les faits datés ?
- Disposez-vous de preuves recevables ?
- Avez-vous respecté les délais légaux de prescription ?
- Avez-vous tenté une résolution interne (RH, CSE, médiation) ?
- La plainte vise-t-elle une infraction pénale ou une faute disciplinaire ?
En cas de doute, contactez un cabinet spécialisé ou un service public d’accès au droit.
FAQ sur les atteintes à la réputation au travail
Toutes les réponses aux questions que vous vous posez.