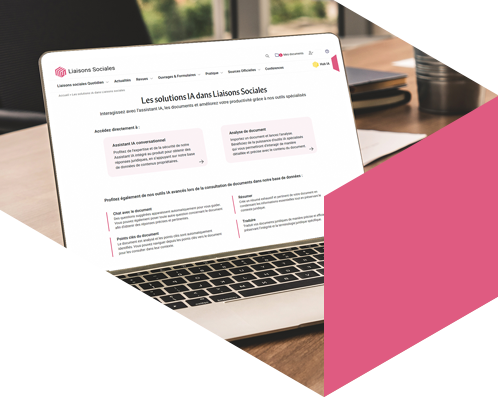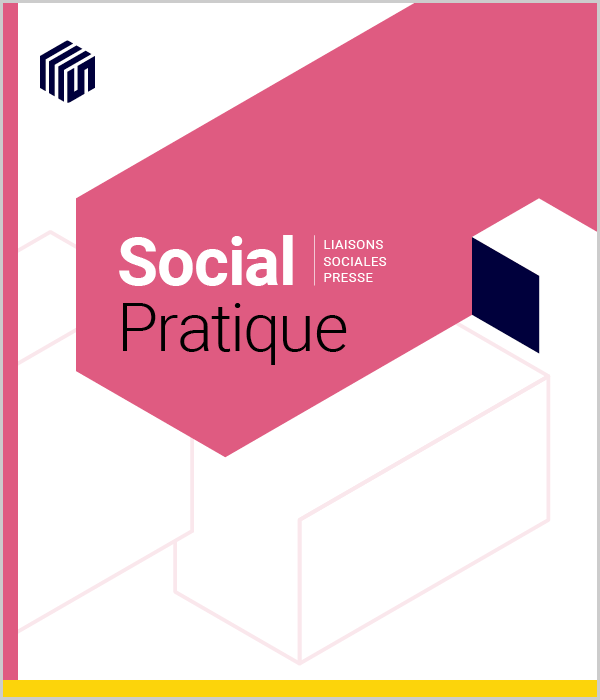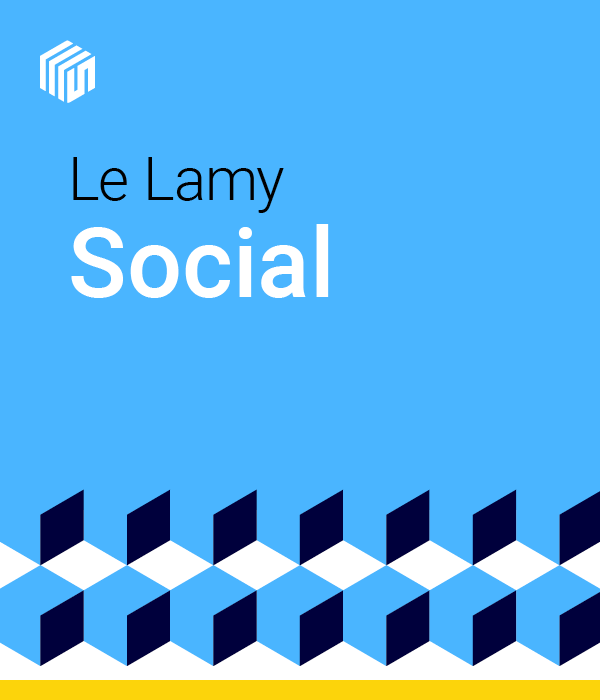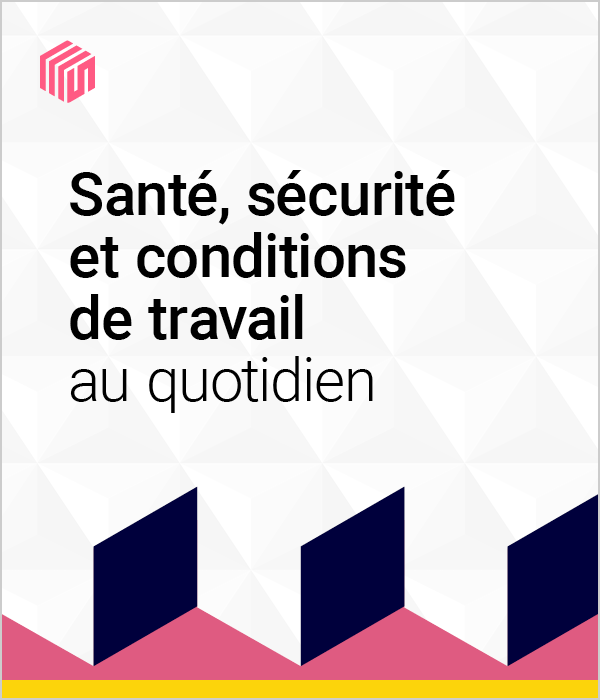La rechute est-elle considérée comme un accident du travail ou une maladie professionnelle ?
En cas de rechute, les suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle suivent le même régime que les lésions initiales. Autrement dit, elles sont prises en charge par la Sécurité sociale, et le salarié bénéficie en principe de la protection de son emploi instituée par le Code du travail.
- La rechute est prise en charge comme l'accident initial.
- Elle peut résulter d'une aggravation ou d'une nouvelle lésion liée à l'accident.
- Le salarié doit prouver la causalité entre la rechute et l'accident initial.
- La rechute doit être déclarée à la CPAM avec un certificat médical.
- Les protections liées à l'accident s'appliquent uniquement chez le même employeur.
- Des exceptions existent, notamment lors du transfert du contrat de travail.


À quelles conditions une rechute peut-elle être prise en charge par la Sécurité sociale ?
En cas d'aggravation de la lésion ou en cas d'apparition d'une lésion nouvelle relevant de la rechute, les troubles qui en résultent pour la victime donnent lieu à une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
L'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure, entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Toutefois, la jurisprudence distingue l'aggravation de la lésion (= rechute), de la simple manifestation des séquelles d'un accident du travail antérieur en dehors de tout événement extérieur (Cass. soc., 12 nov. 1998, no 97-10.140).
La rechute suppose un fait nouveau résultant d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial en relation directe et exclusive avec celui-ci : la rechute ne peut pas être retenue si l'accident de travail initial n'en est pas la cause exclusive (Cass. soc., 19 déc. 2002, no 00-22.482).
Exemple
En revanche, si les lésions sont une manifestation (et non une aggravation), même temporaire, des séquelles d'un accident du travail subi antérieurement, ces troubles n'ont pas lieu d'être pris en charge au titre d'une rechute.
Exemple
Remarque
Comment faire constater la rechute ?
La victime de l'accident du travail initial doit déclarer la rechute à la caisse primaire d'assurance maladie, en l'accompagnant d'un certificat médical. Le double de la déclaration est adressé par la CPAM à l'employeur qui a déclaré l'accident du travail initial « par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ». L'employeur peut émettre des réserves motivées (CSS, art. R. 441-16).
La procédure de reconnaissance de la rechute est encadrée par des délais précis :
- à compter de la réception du certificat médical faisant état de la rechute, la CPAM dispose d'un délai de 60 jours francs pour se prononcer. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, la rechute est reconnue et prise en charge ;
- l'employeur dispose d'un délai de 10 jours francs à compter de la réception du double de la déclaration adressé par la CPAM pour émettre ses réserves motivées, par tout moyen conférant date certaine à leur réception ;
- s'il a reçu des réserves motivées, ou s'il l'estime nécessaire, le médecin-conseil adresse un questionnaire à l'assuré, qui doit le lui retourner dans un délai de 20 jours francs, et lui transmet, le cas échéant, les réserves formulées par l'employeur.
Aucune consultation du dossier par les parties n'est prévue en amont de la décision de la CPAM. L'employeur n'a donc pas accès au questionnaire rempli par l'assuré.
À défaut de notification du double de la déclaration du salarié (ou de la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu) à l'employeur, la décision de prise en charge est inopposable à ce dernier (Cass. 2e civ., 2 mars 2004, no 02-31.157 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, no 07-19.617), ce qui a notamment pour effet d'empêcher la caisse de refacturer le coût de la prise en charge via le taux de cotisation pour les entreprises soumises à la tarification réelle ou mixte.
Remarque
Quels sont les effets, sur le contrat de travail, d'une rechute chez un nouvel employeur ?
Principe. Les dispositions protectrices de l'emploi sont applicables durant la période d'arrêt de travail consécutive à une rechute d'accident du travail survenue chez le même employeur (Cass. soc., 30 nov. 2016, no 15-24.533 ; Cass. soc., 13 mars 2019, no 17-31.805). En revanche, elles ne s'appliquent pas lorsque l'accident du travail initial est survenu au service d'un précédent employeur. Il en va de même de la maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur (C. trav., art. L. 1226-6). En d'autres termes, la protection légale des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne s'impose qu'à l'employeur au service duquel l'accident ou la maladie a eu lieu. Il existe toutefois deux exceptions à ce principe.
Exception en cas d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. En cas de changement légal d'employeur intervenu en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le salarié peut se prévaloir des règles protectrices contre le licenciement auprès du nouvel employeur (Cass. soc., 3 mars 2004, no 02-40.542). Il en va de même en cas d'application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail (Cass. soc., 9 juill. 1992, no 91-40.015).
Exemples
Attention
Exception tirée du lien de causalité. Indépendamment de l'hypothèse d'un transfert du contrat de travail, le salarié peut prétendre aux dispositions protectrices contre le licenciement dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail survenu chez son précédent employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (Cass. soc., 6 mai 2015, no 13-24.035 ; Cass. soc., 9 nov. 2017, no 16-15.710).
L'existence de ce lien de causalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 28 mars 2007, no 06-41.375).
Exemples :
À noter aussi que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass. soc., 7 mai 2024, no 22-10.905). Cette règle s'applique en cas de rechute. Peu importe que la CPAM n'ait pas reconnu le lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude (Cass. soc., 9 juin 2010, no 09-41.040). En l'espèce, dans les rapports employeur-salarié et pour l'application des règles protectrices, l'inaptitude consécutive à la rechute du salarié a été considérée comme ayant un caractère professionnel, les juges ayant estimé que l'employeur avait eu connaissance lors du licenciement (notamment par le biais du certificat médical d'arrêt de travail) que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail initial (déjà en ce sens : Cass. soc., 22 févr. 2006, no 04-44.957).