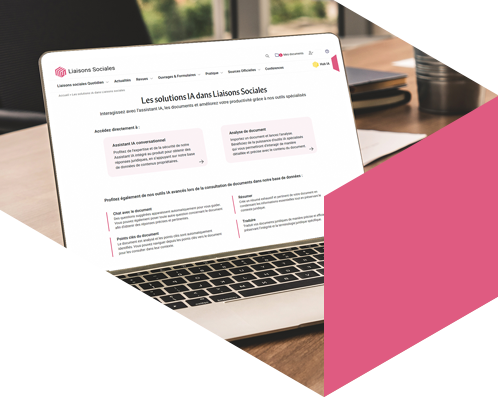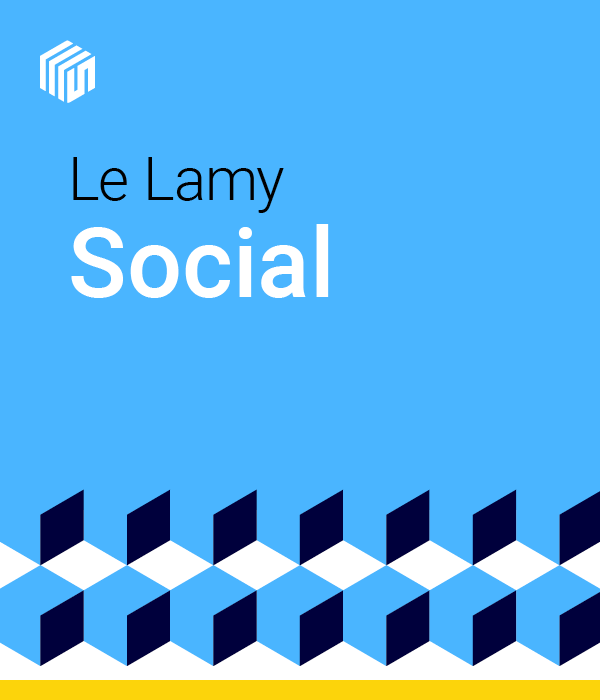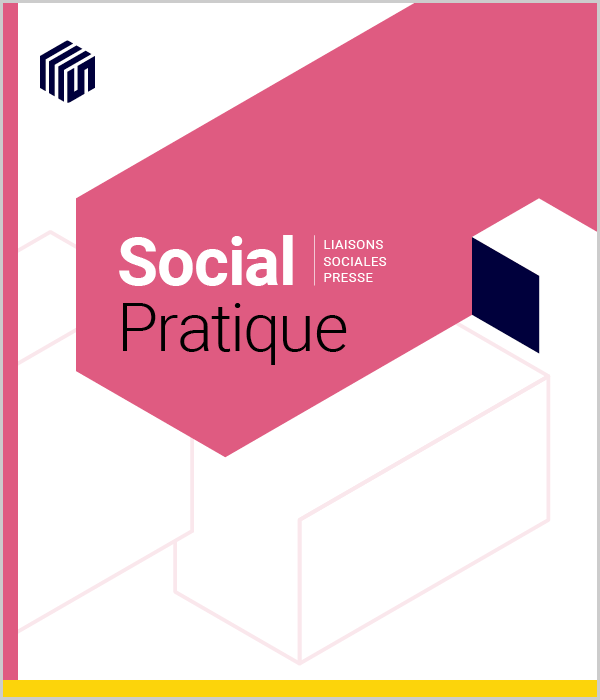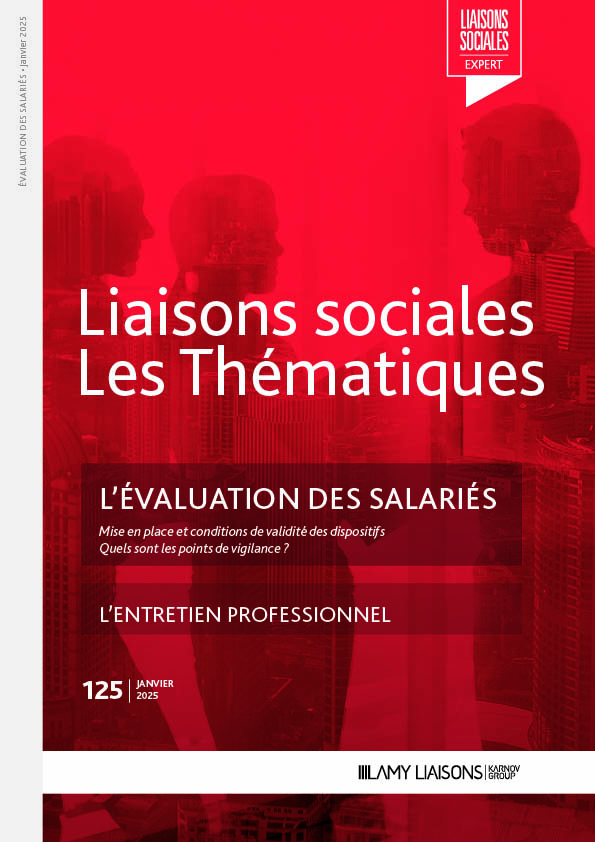Quand et comment l'employeur peut-il justifier une différence de traitement entre salariés ?
Le principe d'égalité de traitement n'interdit pas toute différenciation entre salariés effectuant un même travail ou placés dans une même situation. Certaines différences de traitement sont légalement prévues. D'autres peuvent être prévues par l'employeur ou encore instaurées par un accord collectif. Autrement dit, l'employeur peut opérer des différenciations à condition de les fonder sur des critères objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.
- L’égalité de traitement n’exclut pas toute différenciation.
- La différence doit reposer sur des critères objectifs et vérifiables.
- La rémunération peut être individualisée si les critères sont transparents.
- Le diplôme ou l’expérience ne justifient une différence qu’à l’embauche.
- La performance et la qualité du travail peuvent être prises en compte.
- Des responsabilités ou des tâches différentes peuvent légitimer un écart.
- Le travail de nuit justifie une majoration spécifique.
- L’ancienneté n’est valable que si elle n’est pas déjà valorisée.
- La date d’embauche peut expliquer un traitement différent.
- Des contraintes économiques ou un transfert d’entreprise peuvent le justifier.


- Quels éléments permettent de justifier une différence en matière de rémunération ?
- Quels éléments ne permettent pas de justifier une différence de traitement ?
- Comment se répartit la charge de la preuve du respect du principe « à travail égal, salaire égal » ?
- Dans quels cas les différences de traitement sont-elles présumées justifiées ?
Quels éléments permettent de justifier une différence en matière de rémunération ?
Le principe « à travail égal, salaire égal » ne remet pas en cause le pouvoir de l'employeur d'individualiser les salaires. Ainsi, il peut accorder des augmentations individuelles, dès lors qu'elles ne sont pas discrétionnaires mais décidées en fonction de critères objectifs et vérifiables (Cass. soc., 2 oct. 2001, no 99-17.577). L'employeur ne peut cependant pas invoquer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de rémunération (Cass. soc., 30 avr. 2009, no 07-40.527).
D'une manière générale, l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, à la condition que tous les salariés de l'entreprise, placés dans une situation identique, puissent en bénéficier et que les règles déterminant l'octroi de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables. Les critères d'attribution doivent être portés à la connaissance préalable des salariés concernés (Cass. soc., 10 oct. 2013, no 12-21.167).
Parmi les éléments objectifs permettant de justifier une différence de traitement, on recense des critères reposant sur des motifs individuels tenant au travail fourni ou au profil du salarié, ou des critères plus généraux comme la date d'embauche ou la situation économique de l'entreprise.
Passif du salarié : diplômes et expérience professionnelle. Pour la Cour de cassation, la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, à moins qu'il ne soit démontré que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée (Cass. soc., 14 sept. 2022, no 21-12.175 ; Cass. soc., 21 juin 2023, no 21-23.487).
Exemples :
-
À l'inverse, le fait de détenir un diplôme d'ingénieur, pour un poste exigeant principalement des compétences en matière commerciale, ne justifie pas une rémunération d'embauche plus importante que celle d'un salarié titulaire d'un baccalauréat qui disposait d'une expérience de plus de 20 ans (Cass. soc., 13 nov. 2014, no 12-20.069).
L'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur et les diplômes ne peuvent toutefois justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et à condition d'être en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées (Cass. soc., 11 janv. 2012, no 10-19.438 ; Cass. soc., 24 mai 2023, no 21-21.902 ; Cass. soc., 11 oct. 2023, no 22-17.222).
Qualité du travail accompli. Ont été reconnues comme justifications objectives et pertinentes d'une différence de traitement :
- la performance, généralement rémunérée par des primes dont le calcul doit obéir à des critères objectifs et vérifiables (Cass. soc., 18 janv. 2000, no 98-44.745) ;
- la qualité du travail fourni (Cass. soc., 6 juill. 2011, no 09-66.345).
ATTENTION :
L'employeur peut également invoquer le passé disciplinaire du salarié pour justifier une inégalité entre salariés, y compris des sanctions disciplinaires amnistiées, dès lors que cela lui permet d'assurer ses droits à la défense dans un procès (Cass. soc., 4 juin 2014, no 12-28.740).
Remarque :
Quantité de travail fourni et tâches. Peuvent justifier une différence de traitement entre salariés :
- des tâches plus larges dans un poste de travail identique (Cass. soc., 13 mars 2002, no 00-42.536) ;
- une technicité particulière du poste (Cass. soc., 8 janv. 2003, no 00-41.228) ;
- la charge de responsabilités particulières (Cass. soc., 14 déc. 2010, no 09-67.867).
Horaires de travail. Le travail de nuit peut justifier une différence de rémunération entre les travailleurs de nuit et les salariés en poste durant la journée, voire entre ceux qui travaillent exceptionnellement de nuit et ceux pour lesquels le travail de nuit est habituel (Cass. soc., 5 juin 2013, no 11-21.255). Ainsi, est justifiée une majoration de salaire plus importante pour les heures exceptionnellement travaillées la nuit par des salariés soumis à des heures traditionnelles de bureau, que celle appliquée pour les salariés travaillant habituellement la nuit : cette majoration compense une sujétion différente de celle subie par ces derniers.
Appartenance à une catégorie professionnelle. L'appartenance à une catégorie professionnelle peut justifier une différence de traitement dès lors qu'elle est assise sur des raisons objectives.
Ainsi, s'agissant d'une prime de treizième mois, la Cour de cassation a considéré qu'elle participait de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique (Cass. soc., 26 sept. 2018, no 17-15.101).
Ancienneté. L'ancienneté peut justifier une différence de traitement, à condition qu'elle ne soit pas déjà prise en compte par une prime distincte du salaire de base (Cass. soc., 19 déc. 2007, no 06-44.795 ; Cass. soc., 5 juill. 2023, no 22-18.155). En d'autres termes, l'employeur ne peut pas se contenter d'invoquer l'ancienneté pour justifier la différence de rémunération, dès lors qu'il existe déjà une prime d'ancienneté prenant en compte cet élément (Cass. soc., 8 juin 2011, no 10-15.198).
Date d'embauche. Une différence de traitement entre salariés embauchés à des moments différents peut être licite.
Exemples :
- des salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel peuvent parfaitement bénéficier dans l'avenir d'une évolution de carrière plus rapide que les salariés embauchés antérieurement, dès lors que les premiers ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des seconds qui sont placés dans une situation identique ou similaire (Cass. soc., 3 mai 2018, no 16-11.588) ;
- dans l'hypothèse de l'introduction d'un barème conventionnel de rémunération, l'impossibilité pour un accord collectif de modifier le contrat de travail justifie la différence de traitement entre les salariés engagés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord collectif et ceux engagés postérieurement découlant du maintien, pour les premiers, des dispositions de leur contrat de travail (Cass. soc., 7 déc. 2017, no 16-15.109) ;
- de même, les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent pas revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur (Cass. soc., 28 juin 2018, no 17-16.499).
Quantité de travail fourni et tâches. Peuvent justifier une différence de traitement entre salariés :
- des tâches plus larges dans un poste de travail identique (Cass. soc., 13 mars 2002, no 00-42.536) ;
- une technicité particulière du poste (Cass. soc., 8 janv. 2003, no 00-41.228) ;
- la charge de responsabilités particulières (Cass. soc., 14 déc. 2010, no 09-67.867).
Horaires de travail. Le travail de nuit peut justifier une différence de rémunération entre les travailleurs de nuit et les salariés en poste durant la journée, voire entre ceux qui travaillent exceptionnellement de nuit et ceux pour lesquels le travail de nuit est habituel (Cass. soc., 5 juin 2013, no 11-21.255). Ainsi, est justifiée une majoration de salaire plus importante pour les heures exceptionnellement travaillées la nuit par des salariés soumis à des heures traditionnelles de bureau, que celle appliquée pour les salariés travaillant habituellement la nuit : cette majoration compense une sujétion différente de celle subie par ces derniers.
Appartenance à une catégorie professionnelle. L'appartenance à une catégorie professionnelle peut justifier une différence de traitement dès lors qu'elle est assise sur des raisons objectives.
Ainsi, s'agissant d'une prime de treizième mois, la Cour de cassation a considéré qu'elle participait de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique (Cass. soc., 26 sept. 2018, no 17-15.101).
Ancienneté. L'ancienneté peut justifier une différence de traitement, à condition qu'elle ne soit pas déjà prise en compte par une prime distincte du salaire de base (Cass. soc., 19 déc. 2007, no 06-44.795 ; Cass. soc., 5 juill. 2023, no 22-18.155). En d'autres termes, l'employeur ne peut pas se contenter d'invoquer l'ancienneté pour justifier la différence de rémunération, dès lors qu'il existe déjà une prime d'ancienneté prenant en compte cet élément (Cass. soc., 8 juin 2011, no 10-15.198).
Date d'embauche. Une différence de traitement entre salariés embauchés à des moments différents peut être licite.
Exemples :
- des salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel peuvent parfaitement bénéficier dans l'avenir d'une évolution de carrière plus rapide que les salariés embauchés antérieurement, dès lors que les premiers ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des seconds qui sont placés dans une situation identique ou similaire (Cass. soc., 3 mai 2018, no 16-11.588) ;
- dans l'hypothèse de l'introduction d'un barème conventionnel de rémunération, l'impossibilité pour un accord collectif de modifier le contrat de travail justifie la différence de traitement entre les salariés engagés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord collectif et ceux engagés postérieurement découlant du maintien, pour les premiers, des dispositions de leur contrat de travail (Cass. soc., 7 déc. 2017, no 16-15.109) ;
- de même, les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent pas revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur (Cass. soc., 28 juin 2018, no 17-16.499).
Circonstances extérieures à la personne du salarié. Peuvent justifier une différence de traitement :
- la pénurie de candidats entraînant le risque de fermeture de l'établissement (Cass. soc., 21 juin 2005, no 02-42.658), ce qui a permis de recruter en CDD un remplaçant mieux payé que le titulaire du poste ;
- des contraintes économiques, telles que la réorganisation d'un service (Cass. soc., 24 sept. 2008, no 06-43.504) ;
- la disparité du coût de la vie entre deux régions (Cass. soc., 14 sept. 2016, no 15-11.386).
Transfert d'entreprise. En cas de transfert légal d'entreprise en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (voir nos 220-15 et s.), le maintien des contrats de travail résultant d'une obligation légale, il suffit à justifier la différence de traitement subie par les salariés du nouvel employeur (Cass. soc., 4 déc. 2007, no 06-44.041 ; Cass. soc., 11 janv. 2012, no 10-14.614 ; Cass. soc., 30 mai 2018, no 17-12.782).
En cas de transfert des contrats de travail organisé par la voie conventionnelle (cas de la reprise d'un marché de service), les salariés du prestataire entrant ne peuvent pas revendiquer le bénéfice des avantages maintenus aux salariés repris (Cass. soc., 30 nov. 2017, no 16-20.532 : s'agissant d'une prime contractuelle de treizième mois versée aux salariés repris). Il en est de même en cas d'application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail par les parties (Cass. soc., 23 juin 2021, no 18-24.809).
L'article L. 1224-3-2 du Code du travail prévoit d'ailleurs que les salariés du nouveau prestataire ne peuvent pas invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.
Quels éléments ne permettent pas de justifier une différence de traitement ?
Pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique (statut précaire, intermittents, formateurs occasionnels ou vacataires, permanents, saisonniers, etc.) entre des salariés placés dans une situation comparable au regard de cet avantage ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement (Cass. soc., 15 mai 2007, no 05-42.894 ; Cass. soc., 27 janv. 2015, no 13-17.622 ; CE, 17 mars 2017, no 396835).
De même, le fait que deux salariés occupant un poste équivalent aient été embauchés avec une qualification d'emploi différente ne suffit pas à justifier une différence de rémunération entre eux (Cass. soc., 13 sept. 2023, no 22-11.338).
Comment se répartit la charge de la preuve du respect du principe « à travail égal, salaire égal » ?
Il appartient en principe au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération (C. civ., art. 1353 ; Cass. soc., 4 oct. 2017, no 16-17.425).
L'employeur doit ensuite rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Si cette preuve n'est pas rapportée, il doit verser un rappel de salaire (Cass. soc., 29 nov. 2006, no 05-43.292).
Remarque :
Le juge prud'homal se doit d'apprécier non seulement la réalité des éléments invoqués, mais aussi leur pertinence. Il peut notamment tenir compte, en faveur du salarié, des procès-verbaux d'entretien d'évaluation contenant des appréciations positives sur la qualité du travail fourni (Cass. soc., 20 févr. 2008, no 06-40.085). En cas de rémunération en fonction du chiffre d'affaires réalisé individuellement ou au rendement, le salarié ne peut pas se contenter de faire valoir que sa rémunération est inférieure à la rémunération moyenne perçue par ses collègues. Il doit également apporter des éléments relatifs au chiffre d'affaires réalisé par chacun de ses collègues au regard de son propre chiffre d'affaires (Cass. soc., 20 oct. 2010, no 08-19.748 ; Cass. soc., 30 mai 2012, no 11-11.387).
Remarque :
Dans quels cas les différences de traitement sont-elles présumées justifiées ?
La chambre sociale admet, dans certaines hypothèses, une présomption de justification des différences de traitement instituées par voie d'accord collectif entre salariés appartenant à une même entreprise (Cass. soc., 27 janv. 2015, no 13-14.773). En conséquence de cette présomption, l'employeur n'a pas à prouver que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes. C'est au contraire à celui qui conteste devant les tribunaux une telle inégalité de traitement, salarié ou syndicat, qu'il appartient de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Sur l'application de cette présomption aux différences de traitement instituées par un accord de substitution, entre les salariés de l'entreprise absorbée et ceux de la société absorbante.
La Cour de cassation exclut toutefois formellement une généralisation de cette présomption à toutes les différences de traitement opérées par voie d'accord collectif (Cass. soc., 3 avr. 2019, no 17-11.970). Ainsi, en dehors des hypothèses admises, il appartient à l'employeur de justifier la différence de traitement par des raisons objectives, dont le juge contrôlera la réalité et la pertinence (voir question précédente).
Exemple :
Remarque :
Critères ouvrant droit au bénéfice de la présomption : catégories professionnelles et fonctions distinctes. La présomption de justification des différences de traitement a été reconnue pour la première fois par la Cour de cassation à propos de différences opérées entre des salariés relevant de catégories professionnelles distinctes (Cass. soc., 27 janv. 2015, no 13-14.773 ; Cass. soc., 27 janv. 2015, no 13-22.179). La Cour de cassation estime en effet que l'instauration de telles différences entre catégories professionnelles distinctes par voie d'accord négocié et signé par des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ou de l'établissement les rend légitimes. Les syndicats sont en effet investis de la défense des droits et intérêts des salariés et ont reçu l'habilitation directe de ces derniers, par le biais de leurs votes lors des élections professionnelles.
Remarque :
Depuis, ce mécanisme de présomption a été étendu à des différences opérées par voie d'accord collectif entre salariés exerçant des fonctions distinctes au sein d'une même catégorie professionnelle (Cass. soc., 8 juin 2016, no 15-11.324 ; Cass. soc., 26 avr. 2017, no 15-23.968).
À l'inverse, la présomption de justification ne joue pas entre des salariés d'une même catégorie professionnelle exerçant des fonctions identiques (CE, 15 mars 2017, no 389559).
S'agissant des avantages catégoriels de prévoyance, la Cour de cassation a clairement affirmé que le principe d'égalité de traitement ne s'appliquait qu'entre les salariés d'une même catégorie professionnelle. Autrement dit, des différences de traitement peuvent être instituées entre cadres et non-cadres en matière de protection sociale complémentaire (Cass. soc., 13 mars 2013, no 11-20.490 ; Cass. soc., 9 juill. 2014, no 13-12.121 ; Cass. soc., 9 juin 2021, no 19-23.656 ; Cass. soc., 4 oct. 2023, no 22-12.387).
Remarque :
Critères ouvrant droit au bénéfice de la présomption : salariés relevant d'établissements distincts. Sont également présumées justifiées les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, dès lors qu'elles résultent :
- d'un accord collectif d'établissement négocié et signé par les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement (Cass. soc., 3 nov. 2016, no 15-18.444 ; Cass. soc., 13 déc. 2017, no 16-14.000) ;
- ou d'un accord d'entreprise (Cass. soc., 4 oct. 2017, no 16-17.517).
Cette solution s'applique également s'agissant d'un protocole de fin de conflit lorsque celui-ci a valeur d'accord collectif (Cass. soc., 30 mai 2018, no 17-12.782).
Remarque :
Une différence de traitement a été jugée justifiée en ce qu'elle était la conséquence de l'exercice du droit d'opposition à l'entrée en vigueur d'un accord collectif (Cass. soc., 30 mai 2018, no 16-16.484). Dans cette affaire, deux accords collectifs relatifs à l'aménagement du temps de travail étaient applicables dans l'entreprise, l'un aux cadres, l'autre aux non-cadres. Deux avenants respectifs ont par la suite été signés, mais celui applicable aux non-cadres a été frappé d'opposition majoritaire par un syndicat non signataire. Les salariés non-cadres ne pouvaient donc pas bénéficier des dispositions de l'avenant. Pour la chambre sociale, la différence de traitement qui en résultait entre salariés cadres et non-cadres était justifiée par un élément objectif et pertinent.