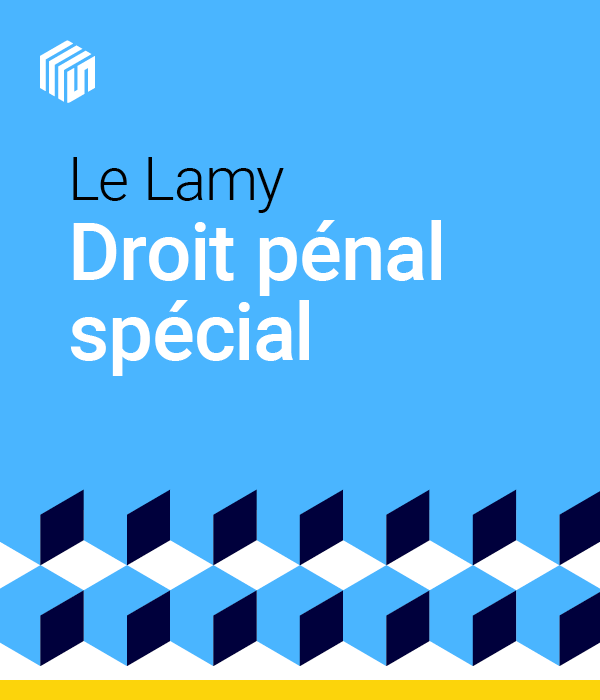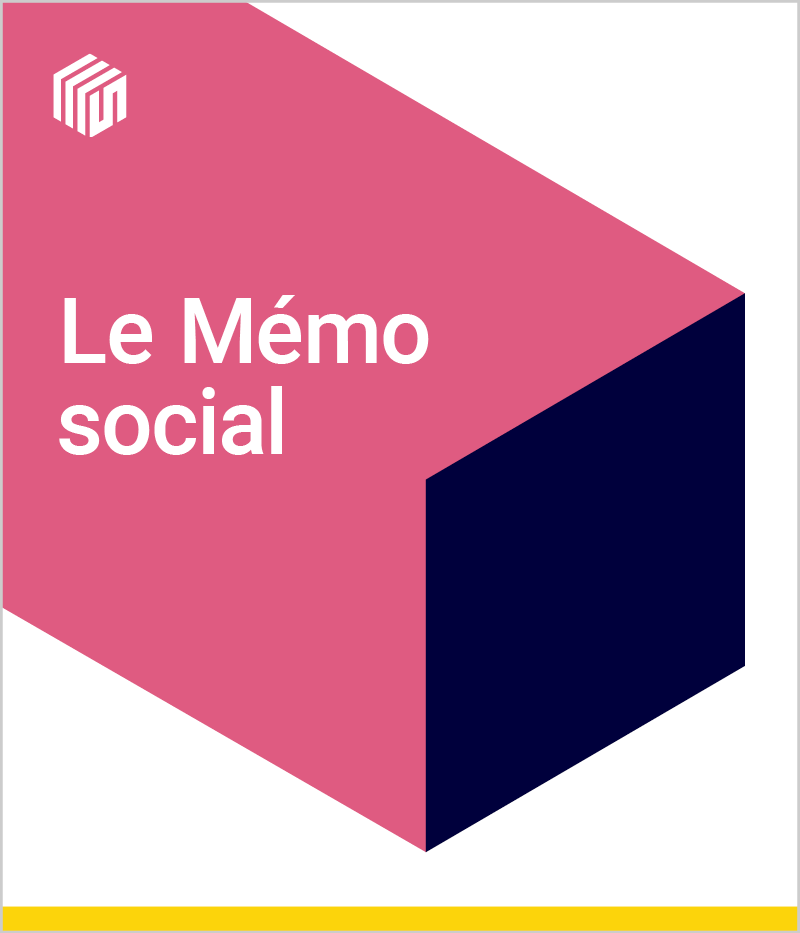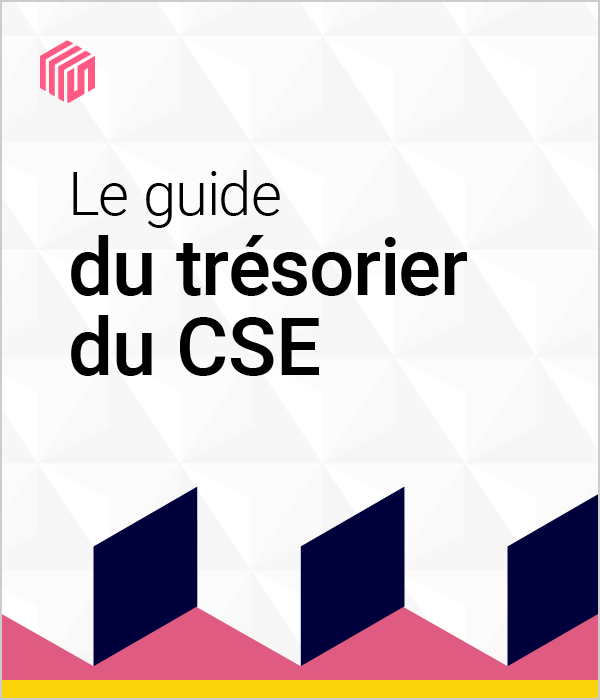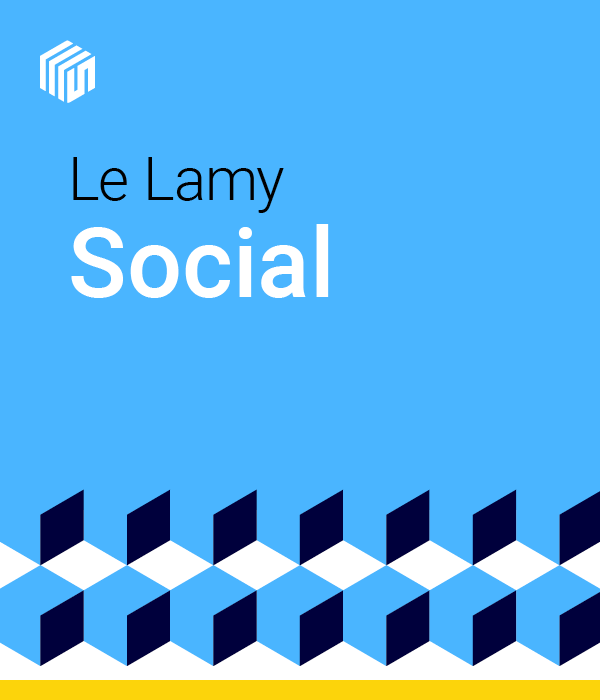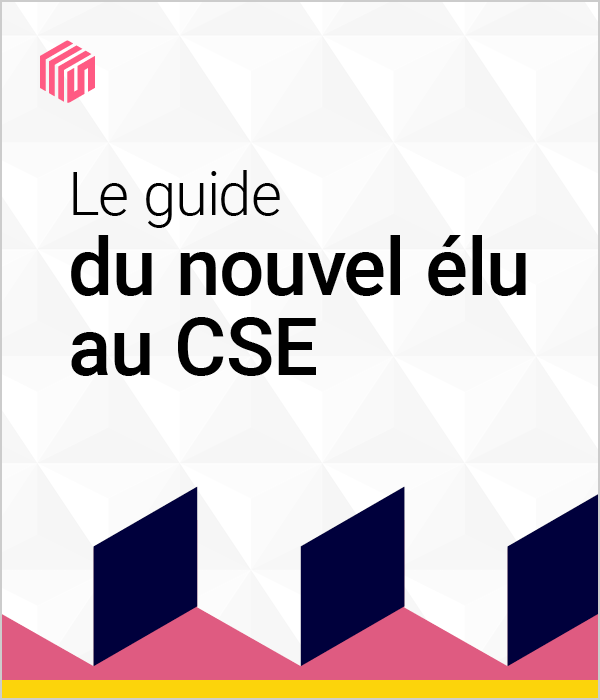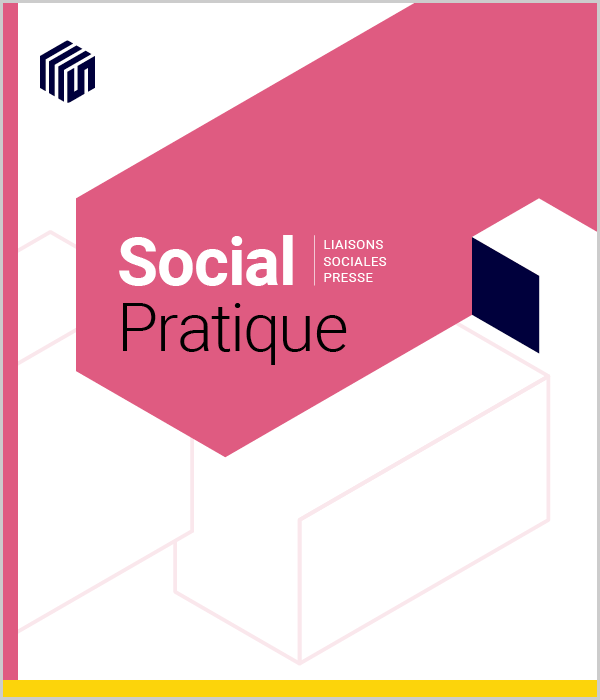Mise en danger de la personne d'autrui en entreprise : comprendre les conséquences légales
La mise en danger d'autrui au travail est une infraction pénale reconnue, même sans accident, dès lors qu'un employé est exposé à un risque grave. Encadrée par le Code du travail et le droit pénal spécial, elle engage la responsabilité de l'employeur ou des collègues en cas de violation manifeste d'une obligation de sécurité.
- Il s’agit d’une infraction pénale définie à l’article 223-1 du Code pénal.
- Il n’est pas nécessaire qu’un dommage corporel survienne pour que l’infraction soit constituée.
- L’infraction repose sur l’exposition directe d’une personne à un risque immédiat de mort ou de blessure, en lien avec une violation d’une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
- Elle peut engager la responsabilité de l’employeur, des encadrants ou des collègues.
- Les sanctions peuvent être pénales (jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende), civiles, et disciplinaires.
- La mise en place d’un DUERP à jour, la formation sécurité et une politique de prévention rigoureuse sont essentielles pour s’en prémunir.


Qu’est-ce que la mise en danger d’autrui au travail ?
Définition juridique du délit de mise en danger
Le délit de mise en danger d’autrui, prévu à l’article 223-1 du Code pénal, sanctionne le fait d’exposer directement une personne à un risque immédiat de mort ou de blessure, en violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Ce délit ne nécessite ni dommage, ni intention de nuire pour être caractérisé.
En entreprise, il prend une forme particulière dès lors que le risque est généré dans le cadre des relations de travail ou des conditions d’exercice professionnel.
Les obligations de sécurité de l’employeur
Tout employeur est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés, comme le prévoit l’article L. 4121-1 du Code du travail.
Il doit :
- évaluer les risques professionnels,
- prévenir les accidents du travail,
- et adapter les mesures de protection à l’évolution des circonstances.
Le non-respect de ces obligations peut engager sa responsabilité civile ou pénale, notamment si une exposition à un risque immédiat est constatée.
Obligations vs risques juridiques
| Obligation légale | Risque en cas de manquement |
|---|---|
| Évaluer les risques professionnels | Sanction administrative ou pénale |
| Mettre à jour le DUERP | Responsabilité pénale en cas d'accident |
| Fournir des équipements de protection adaptés | Qualification de mise en danger délibérée |
| Anciens salariés aux gestes de sécurité | Engagement de la faute inexcusable |
Exemples concrets en milieu professionnel
- Affaire Alstom Power Boilers : condamnation pour exposition à l’amiante, sans information ni équipement de protection. Aucun dommage n’a été constaté, mais le risque immédiat a suffi à fonder l’infraction (CA Douai, 2008).
- Chantiers sans garde-corps : exposer des ouvriers à une chute de hauteur est un cas typique de mise en danger.
- Accès non sécurisé à des zones à haut risque (produits chimiques, zones électriques etc.) : l’absence de restriction ou de signalisation engage la responsabilité de l’encadrement.
Dans tous les cas, les juridictions évaluent le caractère immédiat et concret du risque, indépendamment des conséquences physiques éventuelles.
Quelles sont les responsabilités en cas de mise en danger d’un salarié ?
Responsabilité de l’employeur
En cas de mise en danger avérée, l’employeur peut voir sa responsabilité engagée sur plusieurs plans :
- Pénalement, si la violation d’une obligation de sécurité est manifeste, il peut être poursuivi en tant que personne physique ou morale (article 223-1 du Code pénal).
- Civilement, en cas de faute inexcusable, le salarié victime peut obtenir une indemnisation majorée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 février 2002.
- Administrativement, des sanctions de l’Inspection du travail peuvent également s’appliquer (amende, arrêt temporaire d’activité etc.).
L’obligation de sécurité impose une vigilance constante dans l’organisation du travail.
Responsabilité des cadres ou collègues
La mise en danger d’autrui ne se limite pas à la hiérarchie.
Des cadres intermédiaires, chefs de chantier ou collègues peuvent être tenus responsables s’ils contribuent activement à exposer un salarié à un risque immédiat, par exemple :
- en négligeant de signaler un danger connu,
- en ordonnant l’exécution d’une tâche sans les équipements nécessaires,
- ou en contournant les procédures de sécurité établies par l’entreprise.
Les juridictions apprécient alors l’intention délibérée, ou au contraire l’imprudence fautive, selon les cas.
Cas particulier du harcèlement moral ou physique
Certaines situations de harcèlement moral ou physique peuvent être requalifiées en mise en danger de la personne dès lors qu’elles entraînent une altération grave de la santé du salarié ou exposent à un risque de suicide.
Le harcèlement est réprimé au titre de l’article L. 1152-1 du Code du travail mais peut se cumuler avec le délit de mise en danger si les éléments matériels et intentionnels sont réunis.
La faute de l’employeur peut alors être retenue pour carence dans la prévention des risques psychosociaux.
Quelles sanctions légales en cas de mise en danger avérée ?
Sanctions pénales (article 223-1 du Code pénal)
La mise en danger délibérée d’autrui, dans les conditions prévues par l’article 223-1 du Code pénal est punie de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Des circonstances aggravantes peuvent élever la peine à 5 ans et 75 000 € : mise en danger d’un mineur, d’un agent public ou d’un salarié exposé par sa hiérarchie.
Ce délit peut être retenu même sans dommage constaté, à partir du moment où l’exposition au danger est directe, concrète, et liée à une violation caractérisée des obligations légales.
Sanctions civiles et indemnisation du salarié
En cas de préjudice (accident, infirmité, traumatisme), la victime peut obtenir :
- une réparation intégrale devant le conseil de prud’hommes, ou,
- une majoration des indemnités via la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Dans certains cas, les montants peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros, en fonction :
- de la gravité des séquelles,
- du lien de causalité établi,
- et de l’éventuelle carence dans les mesures de prévention (absence de DUERP, défaut d’équipement, etc.).
L’employeur engage alors sa responsabilité personnelle et financière.
Sanctions disciplinaires en entreprise
Au-delà des poursuites pénales ou civiles, une situation de mise en danger peut donner lieu à des sanctions disciplinaires internes, applicables à tout salarié, y compris les cadres ou supérieurs hiérarchiques.
L’entreprise peut acter la gravité de la faute commise par :
- Un avertissement écrit
- Une mise à pied disciplinaire
- Une mutation ou rétrogradation
- Un licenciement pour faute grave ou lourde
La proportionnalité entre la gravité des faits et la sanction prononcée est essentielle. Un dossier disciplinaire documenté renforce la position de l’employeur en cas de litige.
Comment prévenir la mise en danger d’autrui en entreprise ?
Mettre en place une politique de prévention des risques
La première mesure efficace consiste à structurer une politique de prévention claire, documentée et opérationnelle, conforme au Code du travail – articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
Cette politique repose sur trois piliers :
- Évaluer les risques (audit sécurité, visites terrain)
- Agir via des mesures concrètes
- Suivre les évolutions et réajuster
Mesures préventives et objectifs juridiques
| Mesure préventive | Objectif juridique visé |
|---|---|
| Repérage des situations à risque | Éviter l'exposition directe à un danger |
| Élaboration d'un protocole de sécurité | Respect de l'obligation de prudence |
| Tenue à jour du DUERP | Conformité à l'article R. 4121-1 |
| Suivi et mise à jour des procédures | Réduction des responsabilités pénales |
Former les collaborateurs à la sécurité
La formation continue des salariés est un levier fondamental de prévention. Elle permet de limiter les imprudences et de garantir une connaissance concrète des risques propres à chaque poste.
L’INRS ou le Ministère du Travail proposent des dispositifs spécifiques, en particulier pour les métiers exposés (BTP, industrie, logistique…).
Un manquement à cette obligation peut être retenu comme une carence grave de l’employeur, constitutive d’un élément de mise en danger.
Mettre en place un DUERP à jour (Document Unique)
Obligatoire dès le premier salarié, le DUERP (Document unique d’évaluation des risques professionnels) doit recenser l’ensemble des dangers identifiés et les mesures mises en place pour les réduire.
Ce document, conforme à l’article R. 4121-1 du Code du travail, doit être :
- accessible aux salariés,
- actualisé au moins une fois par an,
- et adapté à chaque unité de travail.
Son absence ou son obsolescence peut constituer une preuve tangible de manquement, facilitant la reconnaissance du délit.
Comprendre la mise en danger de la personne d’autrui en entreprise revient à saisir la nature précise d’un délit qui peut entraîner des conséquences lourdes, sans qu’un accident ne soit nécessairement causé.
Ce comportement, qu’il soit délibéré ou involontaire, est puni par le Code pénal dès lors qu’il expose directement autrui à un risque de mort ou de mutilation.
Il ne suffit pas d’un simple manquement : l’obligation particulière de prudence ou de sécurité doit être violée de manière manifeste et les circonstances aggravantes (fonction de l’auteur, statut du salarié, répétition des faits etc.) sont prises en compte.
Face à ce risque pénal, la mise en œuvre de mesures de prévention constitue le moyen le plus efficace pour protéger à la fois la santé physique des salariés et la responsabilité juridique de l’entreprise.
FAQ
Toutes les réponses aux questions que vous vous posez.
Oui. Le lanceur d’alerte bénéficie d’un statut protecteur, notamment depuis la loi Waserman du 21 mars 2022.
Le signalement peut être effectué :
- auprès d’un référent interne (RH, CSE etc.),
- ou via un canal externe (inspection du travail, procureur de la République).
L’anonymat n’est pas automatique, mais l’entreprise ne peut sanctionner un salarié de bonne foi. Toute mesure de rétorsion est interdite.
Voir aussi l’autorité française de protection des lanceurs d’alerte.
Dans certains cas, oui. La jurisprudence a reconnu le lien entre un manquement grave à l’obligation de sécurité (notamment en cas de harcèlement ou de pression excessive) et un passage à l’acte suicidaire.
Le suicide peut alors être requalifié en accident du travail, engageant la responsabilité civile voire pénale de l’employeur.
Chaque situation est évaluée au cas par cas, selon :
- la documentation des faits,
- les alertes émises,
- et l’éventuelle inaction de la hiérarchie.
Oui. Depuis la réforme du Code pénal en 1994, une personne morale (entreprise, collectivité, association) peut être reconnue coupable d’un délit, y compris celui de mise en danger.
La condamnation peut porter sur :
- une amende pénale,
- une interdiction d’exercer certaines activités,
- une fermeture temporaire d’établissement.
La faute doit être commise pour le compte de la structure par un organe ou un représentant légal.
La prescription pénale de droit commun s’applique :
Le délai est de 6 ans à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour où elle a cessé (dans le cas d’un risque continu).
Cependant, ce délai peut être interrompu ou suspendu, par exemple en cas d’ouverture d’enquête ou de dépôt de plainte.
Le délai de prescription est crucial en matière de preuve, notamment lorsque aucun dommage corporel n’est constaté.