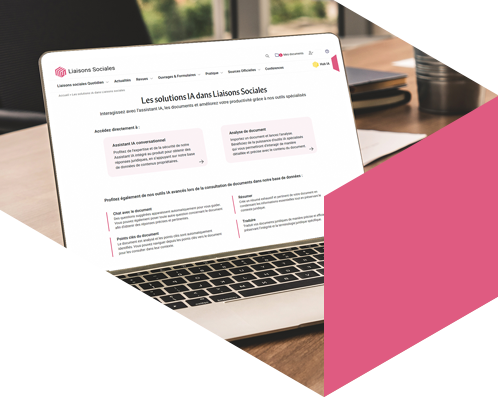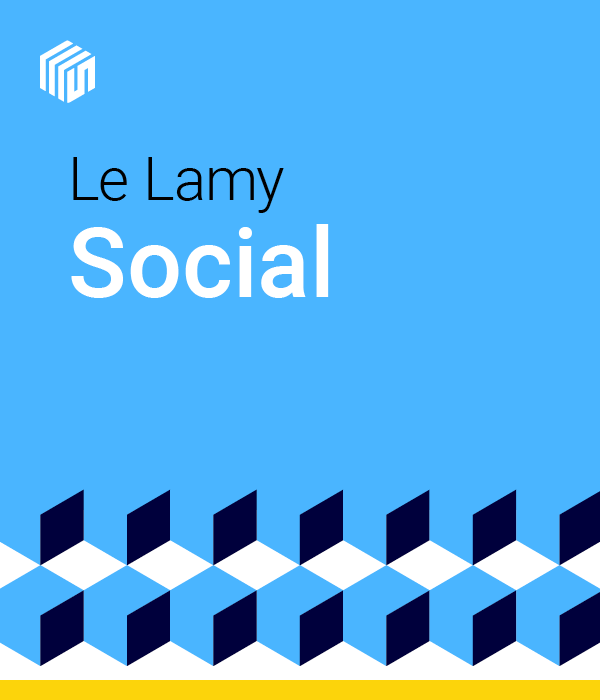Réagir face à un vol commis par un salarié
Comment réagir face à un salarié suspecté ou surpris en train de voler ? Entre droit disciplinaire et droit pénal, l’employeur doit avancer avec méthode et prudence.
- Un salarié est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.
- Le vol ne suffit pas toujours à justifier un licenciement.
- La preuve du vol doit être licite et incontestable.
- Il faut évaluer le contexte, le préjudice et les usages.
- Un aveu écrit ne dispense pas de respecter la procédure.
- La mise à pied conservatoire doit rester encadrée.
- Le dépôt de plainte pénale suspend le délai disciplinaire.
- Le salarié ne peut être retenu sans flagrant délit.
- La retenue sur salaire est interdite, même en cas de vol.
- La responsabilité pécuniaire suppose une faute lourde.


- Comment réagir efficacement face à une infraction en entreprise ?
- Vol en entreprise : pourquoi la faute grave ne peut être présumée automatiquement
- Quelles précautions prendre avant de sanctionner un salarié voleur ?
- Vol en entreprise : dans quels cas peut-on sanctionner un salarié ?
- Sanction disciplinaire du salarié voleur : les erreurs à éviter
- Faut-il attendre une condamnation pénale pour licencier un salarié voleur ?
- Peut-on demander le remboursement des biens volés au salarié ?
- Procédure à suivre après la découverte d’un vol par un salarié
Comment réagir efficacement face à une infraction en entreprise ?
Signe des temps ou de la précarisation du salariat, les vols commis par les salariés dans leur propre entreprise augmentent. En 2006, 29 milliards d’euros de marchandises ont été volées ou perdues en Europe dans le commerce (1). Un tiers de ces vols a été commis par des salariés. Cela va de l’appropriation de denrées périmées à la récupération de fournitures pour la rentrée des classes en passant par la falsification d’écritures pour dissimuler un détournement de fonds. Par crainte d’une relaxe qui innocente le salarié malhonnête, le dépôt de plainte pour vol dans les entreprises est l’exception. La sanction est en règle générale le licenciement. Et dans ce cas, faute de preuve, l’employeur est souvent condamné. Comment faut-il faire pour éviter cet écueil ?
Vol en entreprise : pourquoi la faute grave ne peut être présumée automatiquement
Signe des temps ou de la précarisation du salariat, les vols commis par les salariés dans leur propre entreprise augmentent. En 2006, 29 milliards d’euros de marchandises ont été volées ou perdues en Europe dans le commerce (1) . Un tiers de ces vols a été commis par des salariés. Cela va de l’appropriation de denrées périmées à la récupération de fournitures pour la rentrée des classes en passant par la falsification d’écritures pour dissimuler un détournement de fonds. Par crainte d’une relaxe qui innocente le salarié malhonnête, le dépôt de plainte pour vol dans les entreprises est l’exception. La sanction est en règle générale le licenciement. Et dans ce cas, faute de preuve, l’employeur est souvent condamné. Comment faut-il faire pour éviter cet écueil ?
Un salarié voleur est présumé innocent tant que sa culpabilité n’est pas établie.
Cette présomption d’innocence lui profite également si les preuves rassemblées contre lui sont illicites.
Le juge excuse enfin l’écart de conduite occasionnel ou des vols de faible importance.
Une analyse fine doit donc être engagée avant de prendre toute décision.
En effet, un vol ne suffit pas à renvoyer au chômage celui qui l’a commis.
Encore faut-il :
- prouver l’intention frauduleuse ;
- rassembler des éléments matériels incontestables contre celui qui l’a commis ;
- entendre les raisons qui l’on conduit à voler ;
- mesurer l’importance du préjudice occasionné à la société.
En somme, le vol qui caractérise en principe une faute grave, voire lourde, peut très bien, selon les réponses apportées à ces interrogations, ne pas suffire à justifier même un licenciement pour faute simple.
Quelles précautions prendre avant de sanctionner un salarié voleur ?
Comment prouver l’intention frauduleuse du salarié ?
Pour être considéré comme un voleur, le salarié doit avoir joué un rôle actif dans le vol.
Or, il peut très bien se trouver mêlé à un vol sans être complice ou coauteur du délit. Ainsi, l’implication personnelle d’un salarié dans le détournement de matériel, organisé par son supérieur hiérarchique, n’a pas été jugé avérée alors même qu’il avait procédé au chargement sur un élévateur des marchandises, au mépris de toutes les procédures internes, vers un camion portant des plaques d’immatriculation camouflées (2).
En revanche, s’il est établi que le salarié avait conscience de participer à un vol, le fait que cette infraction soit commise à l’instigation de son supérieur hiérarchique ne retire pas aux agissements du salarié leur caractère fautif et l’expose à un licenciement (3).
Quels éléments matériels sont nécessaires pour prouver le vol ?
Pour pouvoir sanctionner, voire licencier, un salarié ayant commis un vol, il faut être par ailleurs en mesure d’établir la réalité de l’indélicatesse. Il s’agit d’un préalable indispensable. Il n’est pas possible de prendre une telle décision sur la base de simples soupçons. A défaut, la sanction peut être annulée et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Qui plus est, cela est de nature à aggraver le montant des dommages et intérêts auxquels l’entreprise sera condamnée, dans la mesure où l’intégrité morale du salarié aura été mise en cause. En cas de doute, certaines entreprises portent plainte pour se constituer des preuves qu’elles n’ont pas (voir supra).
La preuve du vol doit se faire au moyen de procédés licites.
Pour ce faire, l’entreprise peut utiliser les preuves collectées au moyen des systèmes de vidéosurveillance mis en place dans l’entreprise même s’ils n’étaient destinées qu’à épier la clientèle ou à assurer à distance la sécurité des locaux. Ainsi, le système vidéo installé dans une pharmacie destiné à surveiller la caisse peut être retenu comme mode de preuve d’un licenciement pour faute grave (4). Il en va de même des caméras mises en place dans des entrepôts de rangement (5).
Mais ces données enregistrées ne sont utilisables que si :
- les salariés ont été préalablement informés de la mise place du dispositif de contrôle dès lors qu’il est destiné à les surveiller (6). Cette information préalable n’est toutefois pas requise pour les dispositifs de surveillance des locaux (7) ;
- il a fait l’objet, préalablement à son introduction, d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise (8) ;
- un dossier de déclaration a été déposé auprès de la CNIL, dans la mesure où le système recourt à des moyens informatiques ;
- (s’il s’agit d’un système de vidéo-surveillance et s’il fonctionne dans des lieux ouverts au public tels que magasins, hall d’accueil, rues...), la direction a obtenu une autorisation administrative préalable auprès des services de la Préfecture dans le ressort territorial de laquelle les caméras sont installées (9).
Vol en entreprise : dans quels cas peut-on sanctionner un salarié ?
Attention, tous les vols ne peuvent pas être sanctionnés, notamment par un licenciement.
Le manager doit au préalable s’interroger sur le contexte et les usages de l’entreprise.
Quels sont les motifs du vol à prendre en compte ?
Entre « vol » et « appropriation », la frontière est mince. La jurisprudence retient parfois l’usage ou la tolérance pour excuser un vol. C’est par exemple la consommation de pâtisseries produites dans une boulangerie, de vin dans les cuisines ou de déchets de viande dans les supermarchés (10). Ou encore l’utilisation d’une carte de carburant durant le week-end (11). La tolérance de telles pratiques sur plusieurs années ou la coutume de la profession sont des éléments à prendre en considération avant d’envisager une sanction.
Faut-il tenir compte de l’importance du vol ?
Il convient par ailleurs de tenir compte de l’importance du vol commis.
Les juges semblent porter leur attention sur la valeur de l’objet dérobé. Ils estiment que la remise gratuite de sandwichs à des clients ne justifie pas un licenciement (12). De même, le vol d’un bout de tuyau ne peut suffire à constituer une faute grave (13).
Il en va différemment lorsque la victime du vol est un client ou un fournisseur de l’entreprise.
Même si l’objet soustrait est de faible valeur, il s’agit d’une faute grave (14) car ce comportement nuit à l’entreprise ou à son image.
Sanction disciplinaire du salarié voleur : les erreurs à éviter
Obtenir une démission ou une transaction : une fausse bonne idée
Pris « la main dans le sac », certains responsables tentent d’intimider le coupable par la menace d’une arrestation pour leur faire signer, sur-le-champ, une démission ou une transaction accompagnée d’une procédure de licenciement antidatée notifiée en main propre. Le procédé peut finalement s’avérer inefficace. Ainsi une Cour d’appel a-t-elle annulé une transaction pour vice du consentement dès lors que le salarié, face aux trois directeurs de l’entreprise, avait été menacé d’une plainte pour vol et avait donc subi des pressions pour signer une transaction (15). Cette analyse est tout à fait transposable à la démission obtenue sous la menace. La démission doit être rendue librement, y compris si le salarié est un voleur surpris par son employeur (16).
Porter plainte pour faire pression : une stratégie risquée
Certains employeurs portent plainte contre le voleur « présumé » ou « identifié » dans le seul but de faire pression sur lui et d’obtenir un aveu ou sa démission.
Outre qu’une telle démarche est de nature à altérer l’un et l’autre, elle peut avoir un caractère irréversible.
Il convient en effet de rappeler qu’une fois la plainte déposée, les poursuites échappent à l’employeur. S’il décide de retirer sa plainte, cela n’a normalement pas d’influence sur la poursuite de l’action publique.
L’aveu écrit du salarié suffit-il pour sanctionner ?
D’autres employeurs exigent des aveux écrits du collaborateur, par lesquels il reconnaît avoir commis une faute grave. Or, l’aveu ne peut porter que sur des faits et non sur la qualification de la faute. Il appartient au juge de rechercher si les faits décrits dans l’aveu sont constitutifs d’une faute grave, indépendamment de ce qu’a pu reconnaître le salarié (17). Même avec des aveux écrits la procédure de licenciement doit être respectée. La lettre de licenciement doit être notamment motivée, y compris dans l’hypothèse où le salarié reconnaît par écrit les faits de vols (18).
Quoiqu’il en soit, les aveux écrits du salarié ne sont pas à négliger car ils sont d’un poids décisif en matière de preuve.
Peut-on retenir le salarié contre son gré ?
En l’absence de flagrant délit (19), il n’est pas possible de retenir contre son gré un collaborateur qui refuse de se soumettre à une fouille, le temps de le conduire devant un officier de police judiciaire ou dans l’attente de son arrivée. Dans ce cas, le responsable peut être poursuivi pour séquestration arbitraire. La séquestration s’analyse en effet en la privation de la liberté d’aller et de venir, même limitée dans le temps et sans que le non-usage de violences de la part des intéressés ait une influence sur la constitution du délit (20).
Faut-il attendre une condamnation pénale pour licencier un salarié voleur ?
Pour licencier un voleur, faut-il attendre qu’il soit condamné par la justice ?
L’idée est assez répandue.
Pour certains décideurs, seule la condamnation pour vol par le tribunal correctionnel permet de déclencher le licenciement. Ce qui est bien entendu inexact et même déconseillé.
D’autres espèrent ainsi se constituer des preuves qu’ils n’ont pas ou les consolider lorsqu’elles sont fragiles, grâce à la procédure d’instruction.
Ils portent donc plainte et, dans l’attente de la décision judiciaire, ils suspendent ou n’engagent pas la procédure de licenciement, tant que le juge ne s’est pas prononcé sur la culpabilité du collaborateur indélicat.
Cette démarche est tout à fait licite. Elle a par ailleurs pour effet de suspendre le délai de deux mois imparti à l’employeur, à compter du vol, pour déclencher la procédure disciplinaire (21). Encore faut-il que les poursuites pénales aient été engagées dans le délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du vol.
Cette attitude de grande prudence, explicable lorsque les faits ou les preuves sont fragiles, peut soulever quelques difficultés.
Se pose notamment, pendant cette période, la question du maintien du salarié dans l’entreprise.
Dès lors que sa culpabilité n’est pas avérée, il est préférable de lui permettre de continuer à travailler. Mais l’entreprise, s’exposant dans ce cas à un risque de récidive, un minimum de précautions doivent être prises et les faits et gestes de l’intéressé doivent être surveillés, voire son affectation temporairement modifiée avec son accord.
La solution consistant à notifier au salarié une mise à pied conservatoire jusqu’au prononcé du licenciement, c’est-à-dire y compris pendant la procédure d’instruction pénale, est déconseillée. Outre qu’elle peut couvrir une période trop longue préjudiciable au salarié, privé de ce fait d’appointement et de revenu de substitution, elle expose l’entreprise à un rappel important de salaire si le collaborateur est finalement innocenté.
Le succès de la démarche consistant à porter plainte suppose par ailleurs que les faits reprochés soient constitutifs d’un délit sur le plan pénal (vol, escroquerie, coups, blessures, etc.) car sinon l’affaire risque d’être classée sans suite. Elle est par ailleurs à double tranchant.
Si les suspicions sont avérées et que le salarié est condamné par le tribunal, l’employeur pourra se servir de cette décision à l’encontre de ce dernier. Et en cas de contentieux ultérieur sur le plan prud’homal, il est probable que les juges tiendront compte de la condamnation pénale du salarié pour prendre leur décision.
En revanche, une relaxe de l’intéressé peut faire l’effet d’un camouflet à l’encontre de l’entreprise et permettre au salarié de jouer la carte de la victimisation. Elle interdit en pratique d’envisager même une sanction mineure à son encontre sauf si la décision fait apparaître que le salarié a bien commis certains des faits reprochés mais que ceux-ci sont insuffisants à constituer une infraction au sens pénal du terme.
La prudence commande donc, en ce domaine, de n’intervenir qu’en cas de présomptions sérieuses et concordantes, voire lorsque les faits sont suffisamment graves, qu’ils reposent sur des témoignages précis et qu’ils sont sans discussion imputables au salarié concerné.
En pratique, la saisine du juge pénal doit être réservée au cas où l’entreprise a subi un grave préjudice et souhaite par ce biais pouvoir en obtenir réparation financière. Elle peut également s’envisager lorsque les faits dont elle a eu connaissance ne sont probablement que la partie immergée de l’iceberg. En cas de condamnation du salarié, c’est même alors un licenciement pour faute lourde qui peut être prononcé, et ce quand bien même son éventualité n’aurait pas été envisagé dans la convocation à l’entretien préalable.
Peut-on demander le remboursement des biens volés au salarié ?
Il n’est pas possible de retenir, sur le solde de tout compte du salarié, la valeur des objets dérobés. Il s’agirait d’une sanction pécuniaire prohibée.
Pour obtenir un tel remboursement, l’employeur n’a pas d’autres solutions que de saisir le juge. Mais encore faut-il que la responsabilité pécuniaire du salarié puisse être engagée.
Celle-ci ne peut l’être qu’en cas de licenciement pour faute lourde, ce qui suppose que le salarié ait eu l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise (22). Or, un vol n’est pas obligatoirement commis dans l’intention de porter préjudice à l’employeur. Le juge distingue l’intention coupable dans le vol, qui relève du droit pénal, de la volonté de nuire à l’employeur. Tel est le cas d’un responsable de magasin discount qui a sorti des marchandises sans les payer, ce qui constitue bien un vol, mais n’implique pas, par lui-même, l’intention de nuire à l’employeur (23). Peu importe les stipulations prévues dans le contrat signé par l’intéressé (24).
Pour ce faire, il revient donc à l’employeur de prouver cette intention.
Procédure à suivre après la découverte d’un vol par un salarié
Face à un vol commis par un salarié, il convient de procéder dans l’ordre suivant :
Etape 1 : Interpellation du salarié
Un voleur a été identifié à la suite d’une fouille par un système de vidéosurveillance ou surpris par des témoins.
Il convient tout d’abord d’apprécier la dangerosité de l’individu. De nos jours, il n’est pas rare que le voleur occasionnel fasse parti d’un gang ou soit lui-même un délinquant récidiviste ou violent. Inutile donc de courir des risques inconsidérés !
Il est donc conseillé de faire directement appel à la police judiciaire, mieux à même de procéder à une interpellation. Dans ce cas, l’employeur apporte le double des preuves filmées qu’il a rassemblées et étudie avec la police les meilleures conditions de l’interpellation du salarié dans ou en dehors de son environnement de travail.
Si l’intéressé ne présente aucun caractère de dangerosité, la Direction peut entamer elle-même la procédure qu’elle a annoncée à son personnel. Conformément aux dispositions disciplinaires, la Direction requière un salarié de l’entreprise pour l’accompagner afin « d’appréhender » en sa présence le salarié indélicat. Devant ce témoin, elle met en demeure l’intéressé de restituer le matériel qu’il a volé. S’il refuse d’obtempérer, l’employeur peut lui demander de montrer le contenu de son sac. Dans ce cas, il doit préciser : « Je vous demande de me laisser contrôler le contenu des affaires que vous transportez. Vous pouvez refuser, mais dans ce cas je vous conduis immédiatement devant la police. »
Si l’intéressé persiste dans son refus, l’employeur est en droit de l’appréhender pour le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Il en va ainsi si le salarié a été surpris en flagrant délit de vol (25). Dans ce cas, l’employeur peut retenir l’intéressé pendant le temps nécessaire à son transport devant la police.
(Eventuellement) Etape 2 : Dépôt de plainte contre le salarié
Lorsque l’employeur ne veut pas en rester là et souhaite faire condamner pénalement le salarié indélicat, il dispose de trois options.
Dépôt de plainte auprès de la police judiciaire. L’employeur peut porter plainte auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie la plus proche. Cette plainte fait l’objet d’un numéro de procès-verbal et d’une date. Elle est dactylographiée et remise en double à l’intéressé (26).
Le dépôt de cette plainte va générer une enquête des services de police ou de gendarmerie, qui transmettront les résultats de celle-ci au Procureur de la République. Ce dernier décidera ensuite soit d’un classement sans suite, soit d’une mesure alternative aux poursuites, soit d’une poursuite par l’intermédiaire d’une citation à comparaître devant le tribunal ou la saisine du juge d’instruction.
Plainte entre les mains du Procureur de la République. L’employeur peut déposer plainte directement par courrier auprès du Procureur de la République.
Celui-ci peut décider de classer sans suite cette plainte, ou de renvoyer le dossier auprès des services de police et de gendarmerie pour enquête (27).
Plainte avec constitution de partie civile adressée au juge d’instruction. L’employeur peut enfin déposer une plainte avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d’instruction.
Cette démarche peut être engagée directement sans dépôt de plainte initiale auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République.
La plainte et les documents produits à l’appui doivent être déposés en double exemplaire.
Etape 3 : Notification d’une mise à pied conservatoire en cas de licenciement envisagé
Une fois le salarié interpellé, c’est le moment pour l’employeur de notifier à l’intéressé une mise à pied conservatoire, première étape de la procédure de licenciement qu’il doit engager sans attendre.
Sur l’articulation de la mise à pied avec des poursuites pénales (voir supra).
Etape 4 : Vérification de la réalité des faits et de la validité des preuves
Avant d’engager une procédure de licenciement, il convient de vérifier une dernière fois que la culpabilité du salarié est bien établie et les preuves incontestables.
Inutile d’envisager un licenciement pour vol sur la base de simples soupçons ou sur des indices improbables ou encore sur la base de témoignages discutables.
Etape 5 : Mise en œuvre de la procédure disciplinaire au licenciement
Une fois la responsabilité du collaborateur établie le vol peut entraîner un licenciement pour faute grave ou lourde sans attendre la condamnation pénale du malfaiteur.
L’employeur peut, par mesure de clémence ou compte tenu des circonstances, se contenter de prononcer une sanction.
Etape 6 : Demande de remboursement des objets dérobés
Cette question se pose s’agissant d’objets de valeur significative et dès lors que le salarié n’a pas pu ou voulu les restituer.
Le remboursement peut se faire à l’amiable. Dans la mesure où les retenues sur salaires sont prohibées, il est conseillé de demander au salarié d’effectuer directement le paiement à l’entreprise (en échelonnant, le cas échéant, les versements lorsque le montant est élevé).
Si un tel accord est impossible, l’entreprise n’a comme seule possibilité que de saisir le juge.
S’agissant d’un litige né à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, c’est le conseil des prud’hommes qui est seul compétent.
Précisons que la mise en jeu de cette responsabilité pécuniaire n’est généralement admise par les juges qu’en cas de faute lourde.
Sources :
1. Selon le baromètre européen 2006 sur la démarque inconnue.
(2) Cass. soc., 28 juin 2006, no 04-48.406.
(3) Cass. soc., 21 janv. 2004, no 01-46.820.
(4) CA Bourges, 17 janv. 1992, Kerhao c/ Ciriani.
(5) Cass. soc., 20 nov. 1991, no 88-43.120 ; Cass. soc., 15 mai 2001, no 99-42.219.
(6) Voir note 5 ; Circ. DRT no 93-10, 15 mars 1993, no II-A-3, BOMT no 93-10.
(7) Cass. soc., 31 janv. 2001, no 98-44.290 ; Cass. soc., 19 avr. 2005, no 02-46.295.
(8) Cass. soc., 7 juin 2006, no 04-43.866 (le comité d’entreprise doit être consulté, même si le salarié ne peut ignorer l’existence de caméras vidéo destinées à détecter les vols perpétrés dans l’entreprise et utilisées depuis quatre ans ainsi qu’il ressort de la consultation du CHSCT produite par l’employeur et annoncée par des affichettes dans le magasin).
(9) D. no 96-926, 17 oct. 1996, JO 20 oct. ; Circ. min., 22 oct. 1996.
(10) Cass. soc., 21 déc. 1989, no 87-42.209 ; Cass. soc., 15 nov. 1989, no 86-44.048 ; Cass. soc., 27 mai 1998, no 96-40.928.
(11) Cass. soc., 1er févr. 2005, no 03-40.043.
(12) Cass. soc., 21 mars 2002, no 00-40.776.
(13) Cass. soc., 16 déc. 2003, no 01-47.300.
(14) Cass. soc., 16 janv. 2007, no 04-47.051.
(15) CA Toulouse, 7 oct. 1994, SA Dragages salisiens c/ Delmas.
(16) Cass. soc., 12 janv. 1984, no 81-41.050.
(17) Cass. soc., 13 juin 2001, no 99-42.674.
(18) Cass. soc., 19 mars 1998, no 96-40.391.
(19) Voir note 25.
(20) C. pén., art. 224-1 : le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
(21) C. trav., art. L. 122-44 ; CE, 8 juin 1990, no 76.102, Cah. soc.,. barreau 1990, p. 211.
(22) Cass. soc., 9 juill. 1991, no 89-41.890.
(23) Cass. soc., 26 oct. 2004, no 02-42.843.
(24) Cass. soc., 23 sept. 1992, no 89-43.035.
(25) C. pr. pén., art. 73 : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ».
(26) « Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise » (C. pr. pén., art. 15-3).
(27) C. proc. pén., art. 40.