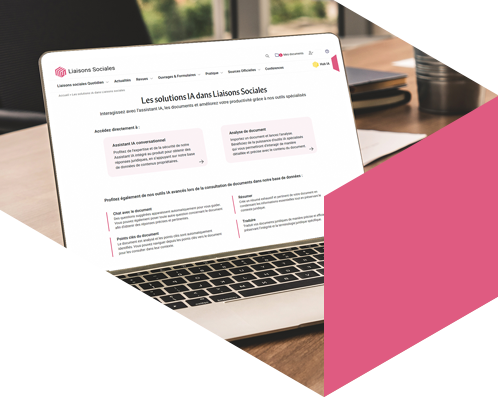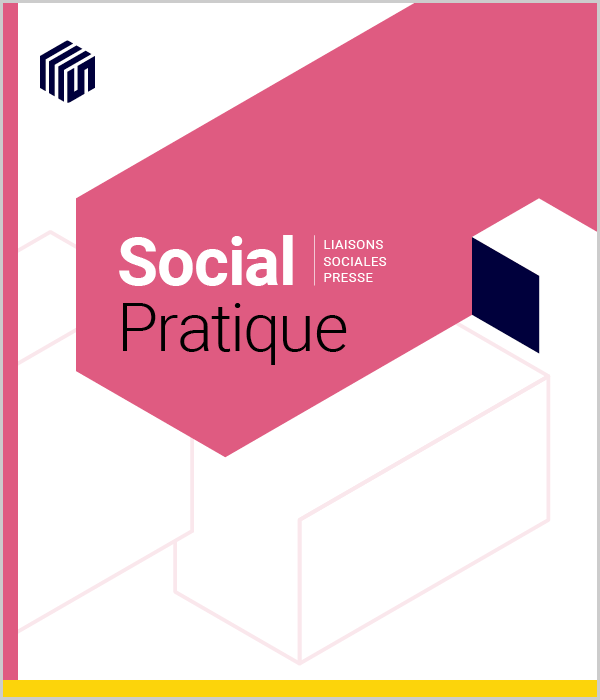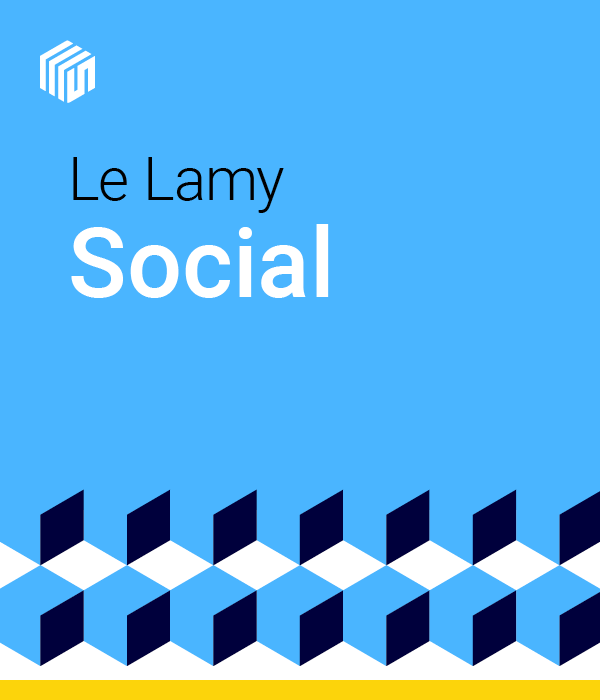Fait religieux en entreprise : le prosélytisme
Le droit du travail tolère l’expression religieuse tant qu’elle reste raisonnable. En cas de prosélytisme abusif, l’employeur peut sanctionner le salarié.
- La liberté religieuse est encadrée en entreprise.
- Le prosélytisme est interdit sur le lieu de travail.
- Il s'agit d’un abus du droit d’expression.
- Le salarié peut être sanctionné, voire licencié.
- Les actes de pression, d’agression ou de harcèlement sont prohibés.
- La jurisprudence illustre et confirme ces principes.
- La clause de neutralité peut encadrer l’expression religieuse.
- Toute restriction doit être justifiée et proportionnée.


Peut-on sanctionner un salarié qui fait du prosélytisme dans l’entreprise ?
Les faits religieux en entreprise sont régis par des principes et des règles qui visent à prévenir les décisions discriminantes. L’expression religieuse dans l’entreprise peut être tolérée dès lors qu’elle respecte les libertés et croyances des autres salariés et qu’elle n’entrave pas l’exécution du contrat de travail. Il en va autrement dès lors qu’elle est abusive et devient un acte de prosélytisme.
Liberté religieuse en entreprise : quel cadre juridique ?
Si la liberté reconnue à chacun d’exprimer ses croyances doit être acceptée et respectée dans ses manifestations raisonnables, en revanche, le prosélytisme est interdit.
Ce comportement consiste à tenter d’imposer à autrui ses idées et ses convictions, en usant de pression, agression ou harcèlement. Le prosélytisme correspond à une déviation de la liberté religieuse, à un exercice abusif des droits que cette liberté garantit.
Selon la Halde, la liberté de religion et de conviction du salarié doit s’exercer dans les limites que constituent l’abus du droit d’expression, le prosélytisme ou les actes de pression ou d’agression à l’égard d’autres salariés (Halde, Délib. nº 2009-117, 6 avr. 2009, point 34).
Prosélytisme au travail : exemples de décisions de justice
Fait un exercice abusif du droit de manifester sa religion et commet des actes de prosélytisme justifiant son licenciement :
- La femme de chambre d’un hôtel qui dépose dans les chambres des clients des publications sur les témoins de Jéhovah (CA Aix-en-Provence, 15 févr. 1989, nº 87/5141).
- Le salarié qui ponctue son activité professionnelle d’invocations et de chants religieux (CA Basse-Terre, 6 nov. 2006, nº 06/00095).
- L’animateur d’un centre de loisirs qui procède à la lecture de la Bible et distribue des prospectus des témoins de Jéhovah dans le cadre de son activité (C. prud’h. Toulouse, 9 juin 1997, nº 09/97, Cahiers prud’h. 1997, p. 156).
- Le salarié travaillant dans un magasin de farces-et-attrapes qui place en évidence, sur un meuble réservé à l’accueil, un drapeau emblème d’une confession, distribue au personnel et à la clientèle des livres religieux en insistant avec véhémence pour qu’ils soient lus sur place. Ce même salarié interpelle clients et passants sur le thème de la religion et diffuse dans le magasin des chants religieux (CA Rouen 25 mars 1997).
Le prosélytisme est d’autant plus condamnable lorsqu’il s’adresse à des personnes vulnérables ou fragilisées, notamment par leur âge ou par leur état de santé :
- Tel est le cas concernant une assistante maternelle exigeant d’un enfant de 5 ans qu’il fasse avant les repas une prière à Jéhovah (CA Toulouse, 21 mai 2008, nº 07/1305).
- Commet une faute grave l’aide à domicile adepte des témoins de Jéhovah qui fait de la propagande auprès des personnes âgées qu’elle assiste (CA Nancy, 30 juin 2006, nº 04/1847, RJS 1/07, nº 155).
- Est justifié le licenciement d’une infirmière travaillant dans une clinique, qui, lors de son service de nuit, contraint une patiente à prier et lui parle de foi et de religion (CA Versailles, 6 déc. 2012, nº 11/02076, RJS 4/13, nº 262).
Jurisprudence récente : quelles évolutions en 2023 ?
La jurisprudence récente continue de confirmer ces principes. Par exemple, la Cour de cassation a rappelé que toute mesure discriminatoire fondée sur les convictions religieuses d'un salarié est prohibée par le Code du travail (C. trav., art. L. 1132-1) et que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (C. trav., art. L. 1121-1).
En outre, la mise en place d'une clause de neutralité dans le règlement intérieur de l'entreprise peut permettre de restreindre la manifestation des convictions religieuses, à condition que ces restrictions soient justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise, et qu'elles soient proportionnées au but recherché (C. trav., art. L. 1321-2-1).