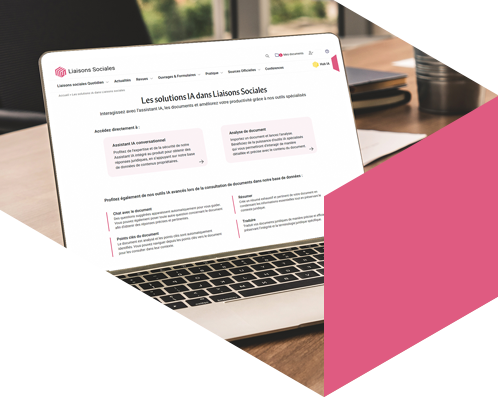Comment distinguer mise à pied disciplinaire et mise à pied conservatoire ?
La mise à pied conservatoire est une mesure facultative qui a pour effet de dispenser le salarié de venir travailler pendant tout le temps que va durer la procédure disciplinaire. Autrement dit, le salarié est écarté de l'entreprise jusqu'à la notification de la sanction qui sera en définitive retenue. Il s'agit d'une mesure conservatoire qui, contrairement à la mise à pied disciplinaire, n'a pas la nature d'une sanction et n'épuise donc pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
- La mise à pied conservatoire est une mesure temporaire sans caractère disciplinaire.
- La mise à pied disciplinaire est une sanction suspendant le contrat de travail.
- Seule une faute grave ou lourde justifie une mise à pied conservatoire.
- L'employeur doit engager rapidement la procédure disciplinaire après mise à pied conservatoire.
- La mise à pied conservatoire est rémunérée, sauf en cas de faute grave/lourde.
- Le salarié protégé peut être mis à pied, mais sous conditions spécifiques.
- Une notification écrite est recommandée pour éviter toute ambiguïté.
- Un retard dans la procédure peut requalifier la mise à pied conservatoire en sanction.
- L'employeur peut changer d’avis et prononcer un licenciement non disciplinaire.
- Une double sanction est interdite, sous peine d’annulation de la sanction finale.


- Dans quelles circonstances peut-on prononcer une mise à pied conservatoire ?
- Quelle procédure respecter pour prononcer une mise à pied conservatoire ?
- La mise à pied conservatoire doit-elle être rémunérée ?
- L'employeur peut-il prononcer une mise à pied conservatoire à durée déterminée ?
- Un salarié protégé peut-il être mis à pied à titre conservatoire ?
Dans quelles circonstances peut-on prononcer une mise à pied conservatoire ?
Seule une faute grave ou lourde permet de justifier le recours à une mesure de mise à pied conservatoire (Cass. soc., 27 nov. 2007, no 06-42.789), c'est-à-dire un comportement d'une gravité telle qu'elle ne permet pas un maintien dans les fonctions. Mais cela n'a rien d'obligatoire. En effet, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à la procédure n'interdit pas à l'employeur d'invoquer ensuite une faute grave (Cass. soc., 28 mars 2001, no 98-43.610 ; Cass. soc., 9 nov. 2005, no 03-46.797 ; Cass. soc., 2 mai 2024, no 22-13.869).
La sanction finalement retenue peut être un licenciement ou une sanction moindre, telle une mise à pied disciplinaire. L'employeur peut en effet renoncer au licenciement après l'entretien préalable. Dans ce cas, la durée de la mise à pied conservatoire effectuée s'impute sur la durée de la mise à pied disciplinaire (Cass. soc., 5 juill. 2006, no 03-46.361).
En outre, le licenciement prononcé après une mise à pied conservatoire ne revêt pas nécessairement un caractère disciplinaire (Cass. soc., 3 févr. 2010, no 07-44.491).
À l'issue de la mise à pied conservatoire, l'employeur peut donc :
- prononcer une sanction telle qu'une mutation disciplinaire, une rétrogradation, un licenciement pour motif disciplinaire ou une mise à pied disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire s'imputant alors sur celle-ci ;
- ou bien renoncer à toute sanction.
S'il décide finalement de ne pas prononcer de sanction proprement dite, l'employeur peut alors licencier l'intéressé pour un motif autre que disciplinaire. En pratique, il semble que l'insuffisance professionnelle soit le seul motif qui puisse être invoqué dans cette hypothèse, dans la mesure où elle se situe parfois à la frontière de la sphère disciplinaire.
Ainsi, un salarié a pu être licencié pour insuffisances, négligences et désintérêt manifeste dans l'accomplissement de son travail. L'employeur s'était d'abord placé sur le terrain disciplinaire en notifiant au salarié une mise à pied conservatoire puis, s'était ravisé et avait finalement licencié le salarié pour insuffisance professionnelle (Cass. soc., 3 févr. 2010, no 08-44.278).
En conclusion, l'employeur qui engage une procédure disciplinaire et met à pied un salarié peut, en cours de procédure, changer d'avis, renoncer à toute sanction et licencier finalement le salarié pour un motif non disciplinaire. Mais attention, il lui est en revanche interdit de prononcer une mise à pied conservatoire en dehors de toute procédure disciplinaire.
Quelle procédure respecter pour prononcer une mise à pied conservatoire ?
La mise à pied conservatoire n'est soumise à aucun formalisme. L'employeur peut la prononcer oralement avec effet immédiat. Pour des raisons de preuve, il a cependant intérêt à la confirmer immédiatement par écrit. Cette lettre doit être précise afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait qu'il s'agit bien d'une mise à pied conservatoire et non disciplinaire. Concrètement, ce courrier doit soit faire référence à la future sanction envisagée (éventuel licenciement ou décision à intervenir par exemple), soit, et c'est la solution la plus simple, préciser le caractère conservatoire de la mise à pied prononcée.
Remarque :
L'employeur qui notifie une mise à pied conservatoire doit immédiatement engager la procédure disciplinaire qui aboutira à la sanction, en convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement (Cass. soc., 19 sept. 2007, no 06-40.155). Si l'employeur n'engage pas immédiatement la procédure de licenciement, et qu'il ne dispose d'aucun motif justifiant ce délai d'attente, la mise à pied sera qualifiée de sanction disciplinaire. Dès lors, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Exemple :
En revanche, est régulière la mise à pied conservatoire suivie de l'envoi, dès le lendemain, de la convocation du salarié à un entretien préalable (Cass. soc., 20 mars 2013, no 12-15.707). Un délai de trois jours a également été jugé admissible (Cass. soc., 26 mai 2010, no 08-45.286).
La nécessité de mener des investigations complémentaires peut justifier un délai plus long (Cass. soc., 13 sept. 2012, no 11-16.434). En revanche, des pourparlers relatifs à une éventuelle signature d'une rupture conventionnelle et à la cession des parts sociales détenues par le salarié ne justifient pas un délai plus long (Cass. soc., 2 févr. 2022, no 20-14.782).
À noter que le fait pour l'employeur de renoncer à la mise à pied conservatoire, en demandant au salarié de reprendre le travail, n'a pas pour effet de requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire (Cass. soc., 18 mai 2022, no 20-18.717). Par exemple, si l'employeur décide de réintégrer le salarié après l'entretien préalable, dans l'attente de la décision définitive, la mise à pied ne perd pas pour autant son caractère conservatoire pour devenir disciplinaire (Cass. soc., 13 juin 2018, no 16-27.617).
Par exception, lorsque les faits fautifs commis par le salarié font l'objet de poursuites pénales, l'employeur peut prononcer la mise à pied conservatoire du salarié et différer la convocation à l'entretien préalable jusqu'à l'issue de la procédure pénale (Cass. soc., 4 déc. 2012, no 11-27.508). Un tel différé est admis s'il est indispensable à l'employeur pour mener à bien des investigations sur les faits reprochés et déterminer la nécessité d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié (Cass. soc., 13 sept. 2012, no 11-16.434 ; Cass. soc., 20 mai 2015, no 14-11.767).
Exemple :
En pratique, deux lettres peuvent être adressées au salarié : l'une lui notifiant sa mise à pied conservatoire et l'autre le convoquant à l'entretien préalable si la sanction consiste en un licenciement. L'employeur peut également se contenter d'envoyer une seule lettre dans laquelle il signifie la mise à pied et convoque le salarié audit entretien.
Si la mise à pied est prononcée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, laquelle fixerait un délai maximum pour le prononcé de la sanction définitive, elle s'analyse en une mise à pied conservatoire à condition que la lettre de licenciement soit finalement envoyée avant l'expiration de ce délai (Cass. soc., 30 sept. 2004, no 02-44.065).
Attention :
Si le licenciement pour faute grave faisant suite à la mise à pied conservatoire est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit d'obtenir le remboursement des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire. En revanche, cette déqualification de la faute n'a pas pour effet de requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire (Cass. soc., 16 mai 2018, no 17-11.202).
La mise à pied conservatoire interrompt le délai de deux mois au-delà duquel les faits fautifs sont prescrits.
La mise à pied conservatoire doit-elle être rémunérée ?
La mise à pied conservatoire est obligatoirement rémunérée sauf si la sanction définitive est un licenciement pour faute grave (Cass. soc., 3 déc. 2002, no 00-44.080 ; Cass. soc., 18 déc. 2012, no 11-22.607) et, a fortiori, lourde (Cass. soc., 3 févr. 2004, no 01-45.989). Autrement dit, si l'employeur fonde le licenciement sur une faute simple ou un motif non disciplinaire, il doit impérativement verser le salaire correspondant à cette période de mise à pied. S'il ne le fait pas, la mise à pied conservatoire non rémunérée et non suivie par un licenciement pour faute grave ou lourde s'analyse nécessairement en une sanction disciplinaire et ne peut donc pas être qualifiée de mise à pied conservatoire (Cass. soc., 3 févr. 2004, no 01-45.989 ; Cass. soc., 18 déc. 2013, no 12-18.548).
L'employeur qui déciderait volontairement de rémunérer la mise à pied ne perd pas le droit de se prévaloir de la faute grave à l'encontre du salarié (Cass. soc., 16 mars 1994, no 92-43.151 ; Cass. soc., 17 janv. 2001, no 97-40.288).
Si la sanction finalement retenue est une mise à pied disciplinaire (suspension du contrat de travail non rémunérée), sa durée s'impute sur celle de la mise à pied conservatoire, ce qui permet de ne pas rémunérer la mise à pied conservatoire en tout ou partie (Cass. soc., 5 juill. 2006, no 03-46.361).
Si la mise à pied conservatoire a été prononcée à tort, l'employeur doit rembourser au salarié les salaires couvrant cette période, peu important qu'il ait été placé en arrêt maladie durant cette période (Cass. soc., 18 févr. 2016, no 14-22.708). Le principe est le même s'agissant d'un salarié protégé (Cass. soc., 29 mars 2023, no 21-25.259).
Remarque :
L'employeur peut-il prononcer une mise à pied conservatoire à durée déterminée ?
Oui. Tant qu'elle est notifiée dans l'attente de la décision de l'employeur dans la procédure de licenciement engagée, la mise à pied reste conservatoire. Peu importe qu'elle soit à durée déterminée (Cass. soc., 18 mars 2009, no 07-44.185).
Exemple :
Un salarié protégé peut-il être mis à pied à titre conservatoire ?
En cas de faute grave, et a fortiori de faute lourde, commise par un représentant du personnel ou un représentant syndical, l'employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire immédiate jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail qui doit autoriser le licenciement (C. trav., art. L. 2421-3). Durant cette période, le salarié n'a pas à être rémunéré. La mise à pied (qu'elle soit conservatoire ou disciplinaire) ne suspend pas le mandat de représentant du personnel : l'employeur doit laisser le salarié entrer et circuler librement dans l'entreprise pour y exercer son mandat, lui accorder son crédit d'heures de délégation, le convoquer aux réunions de son institution, etc. (Cass. soc., 2 mars 2004, no 02-16.554). S'il s'oppose à l'exercice du mandat pendant la période de mise à pied, y compris s'il s'agit d'une mise à pied conservatoire, il commet un délit d'entrave et peut donc être poursuivi pénalement pour ce délit (Cass. crim., 11 sept. 2007, no 06-82.410).
L'employeur doit effectuer les formalités suivantes :
- s'il s'agit d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un salarié inscrit sur la liste des conseillers du salarié, d'un conseiller prud'homme, d'un défenseur syndical, etc. : notifier à l'inspecteur du travail la mise à pied conservatoire dans les 48 heures de sa prise d'effet (C. trav., art. L. 2421-1 ; C. trav., art. L. 2421-2). L'employeur convoque ensuite le salarié à un entretien préalable, puis formule sa demande d'autorisation de licenciement, sans qu'aucun délai d'envoi ne soit exigé. En cas de litige, l'employeur doit être en mesure de prouver, à peine de nullité de la mise à pied conservatoire (CE, 15 nov. 1996, no 160601 : Cass. soc., 18 janv. 2017, no 15-24.599), qu'il a bien effectué cette notification dans le délai (Cass. soc., 30 janv. 2008, no 06-42.564). Si la notification n'a pas été effectuée dans le délai, cela entraîne la nullité de la mise à pied conservatoire, mais n'affecte pas la procédure disciplinaire et la régularité de la sanction prise (Cass. soc., 18 janv. 2017,précité) ;
- pour les autres représentants du personnel : dans les entreprises de 50 salariés et plus, consulter le CSE, dans un délai de 10 jours à compter de la date de la mise à pied, afin qu'il donne son avis sur le licenciement envisagé, puis adresser la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail dans les 48 heures suivant la délibération du comité. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ou en l'absence justifiée de CSE, la demande d'autorisation doit être présentée dans les huit jours de la mise à pied (C. trav., art. R. 2421-14).
Si l'inspecteur du travail refuse l'autorisation de licenciement, la mise à pied conservatoire est annulée (C. trav., art. R. 2421-14). Le salarié doit reprendre ses fonctions antérieures et a droit au versement de la rémunération correspondant à la période de suspension du contrat de travail (Cass. soc., 18 juill. 2000, no 99-41.413). L'employeur ne peut pas échapper au remboursement des salaires en prononçant une mise à pied disciplinaire pour la période couvrant celle de la mesure conservatoire : lorsque l'inspecteur du travail a refusé une autorisation de licenciement disciplinaire, l'employeur n'est pas autorisé à prendre une sanction autre (Cass. soc., 7 nov. 1990, no 87-45.696). Il a même été jugé que si le salarié était en grève pendant toute la durée de la mise à pied conservatoire, il a droit malgré tout au paiement des salaires correspondant à cette période. Pourtant, le principe veut que le salarié gréviste ne perçoive pas sa rémunération durant sa participation à un mouvement de grève. La Cour de cassation considère néanmoins qu'en cas d'annulation de la mise à pied, les salaires doivent être remboursés, même s'il préexistait une autre cause justifiant leur non-paiement (Cass. soc., 17 déc. 2002, no 00-40.633). En tout état de cause, le fait de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié protégé mis à pied à titre conservatoire constitue une violation, par l'employeur, du statut protecteur et de ses obligations contractuelles, qui s'analyse en un licenciement nul (Cass. soc., 4 févr. 2004, no 01-44.962).