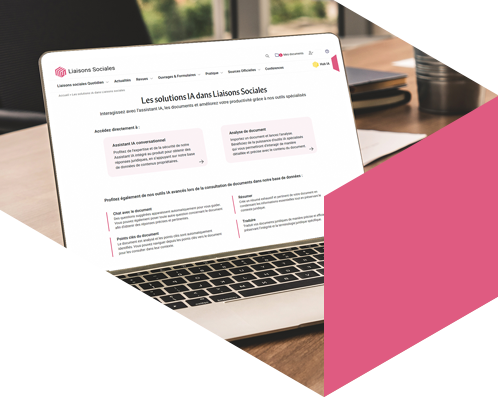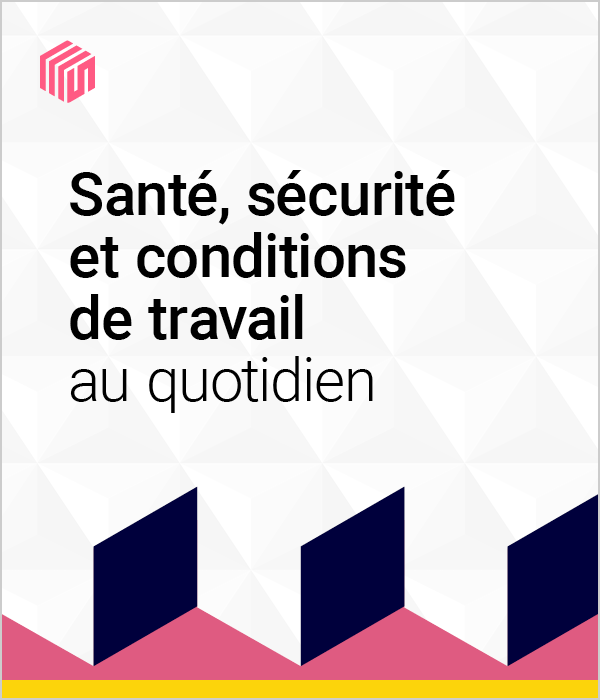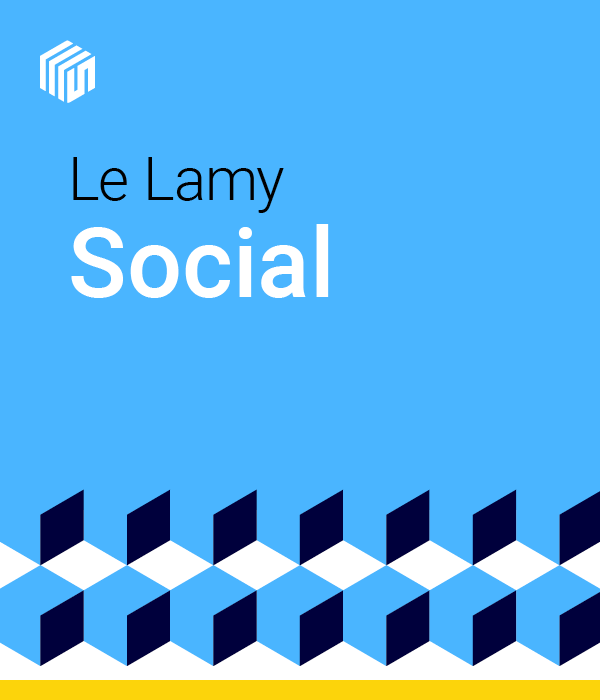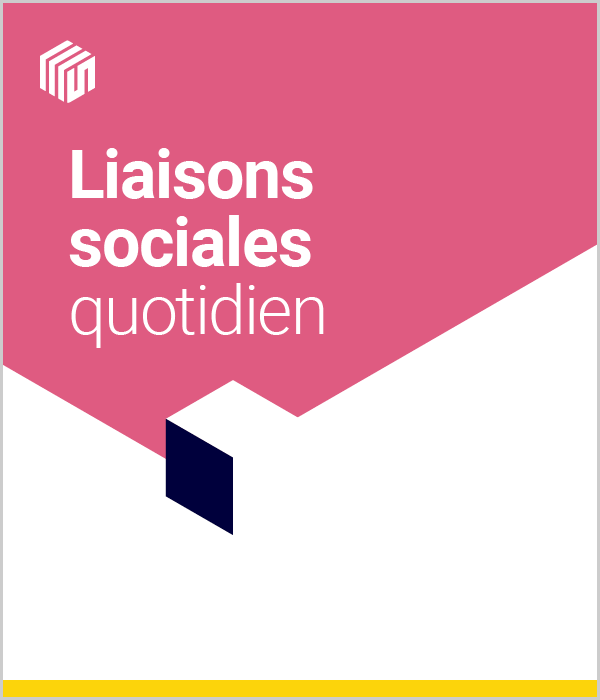Pratique religieuse en entreprise : Tenues vestimentaires autorisées et interdites
En principe, la façon de se vêtir relève du seul choix du salarié. C'est une liberté individuelle mais non une liberté fondamentale. Ainsi, si le règlement intérieur peut rendre obligatoire le port d'une tenue de travail, c'est à la condition que cette mesure soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée par rapport à l'objectif de la protection recherchée.
- Le choix vestimentaire relève de la liberté individuelle du salarié.
- L'employeur peut imposer une tenue si cela est justifié et proportionné.
- Ces obligations peuvent figurer dans le contrat, la convention collective ou le règlement intérieur.
- Une clause de neutralité peut interdire les signes religieux visibles, si elle est générale et justifiée.
- Seuls les salariés en contact avec la clientèle peuvent être concernés par cette clause.
- Toute restriction doit respecter la liberté de religion garantie par le droit français et européen.
- Une application discriminatoire ou non justifiée des règles est illégale.
- La jurisprudence encadre strictement ces restrictions pour éviter toute discriminatoire.


Quand l’employeur peut-il imposer une tenue vestimentaire ?
Les contraintes vestimentaires imposées par l'employeur peuvent figurer au contrat de travail du salarié. C'est souvent le cas lorsque ces contraintes sont justifiées par la sécurité, la protection des salariés ou le secteur professionnel de l'entreprise (contact avec la clientèle notamment). Ces mentions peuvent aussi figurer dans la convention collective applicable à l'entreprise, ou être mentionnées au règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service si l'entreprise ne dispose pas de règlement intérieur.
Port de signes religieux au travail : que dit la loi ?
La liberté de religion est une liberté fondamentale, proclamée par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En droit français, l'article L. 1132-1 du Code du travail prohibe toute sanction liée aux convictions religieuses du salarié.
Selon la CJUE, une clause du règlement intérieur peut interdire le port de tout signe visible de convictions politiques, religieuses ou philosophiques au travail (clause de neutralité), dès lors qu'elle est justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires . Le règlement intérieur (ou une note de service) peut donc contenir une clause de neutralité à condition qu'elle soit générale et indifférenciée, en interdisant aussi bien les signes religieux que politiques ou philosophiques sur le lieu de travail, et de n'appliquer cette restriction qu'aux salariés en contact avec la clientèle.
Que dit la jurisprudence sur les tenues à caractère religieux ?
- CJUE, 15 juillet 2021 : La CJUE a retenu qu'une règle interne d'une entreprise, interdisant aux travailleurs de porter tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, ne constitue pas, à l'égard des travailleurs qui observent certaines règles vestimentaires en application de préceptes religieux, une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions, dès lors que cette règle est appliquée de manière générale et indifférenciée.
- Cass. soc., 22 novembre 2017 : La Cour de cassation a clarifié la question de l'évocation du port de signes religieux dans le règlement intérieur. Pour les Hauts Magistrats, l'employeur peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe religieux, mais aussi politique ou philosophique, sur le lieu de travail, à condition toutefois que cette clause générale et indifférenciée ne soit appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients.
- Cass. soc., 8 juillet 2020 : La Cour de cassation a jugé que l'interdiction faite à un salarié de porter la barbe lors de l'exercice de ses missions, en tant qu'elle manifesterait des convictions religieuses et politiques, et l'injonction faite par l'employeur de revenir à une apparence considérée par ce dernier comme plus neutre constituent une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié. Aucune exigence professionnelle essentielle et déterminante ne permettait de justifier en l'espèce une telle discrimination.
L'employeur peut imposer des contraintes vestimentaires, la seule limite étant l'exigence de justification et de proportionnalité de cette restriction. Dans certaines situations, les restrictions à la liberté de se vêtir peuvent conduire à une discrimination. Il en est ainsi lorsque derrière l'atteinte injustifiée à cette liberté, se dissimule une discrimination en raison de l'orientation sexuelle ou des convictions religieuses.