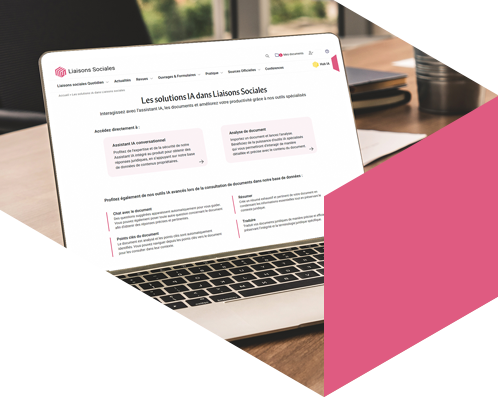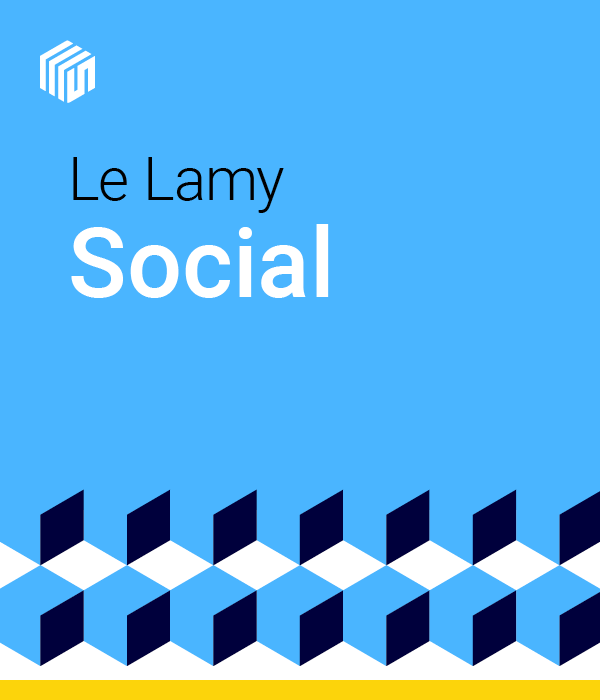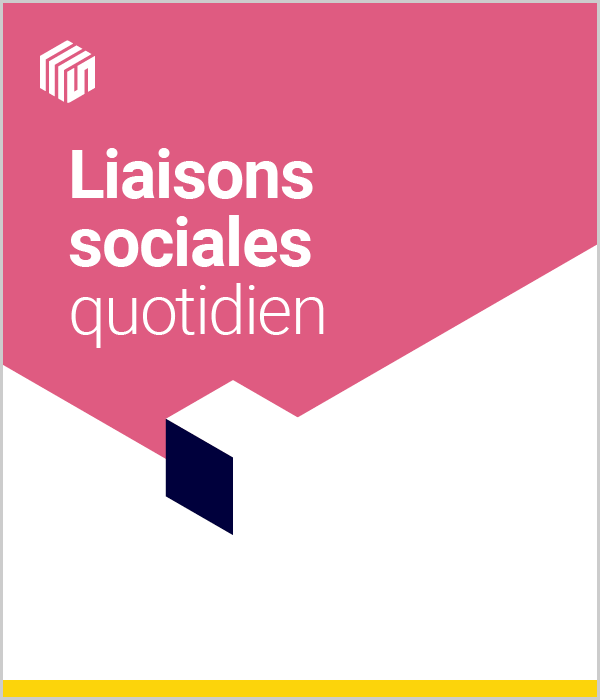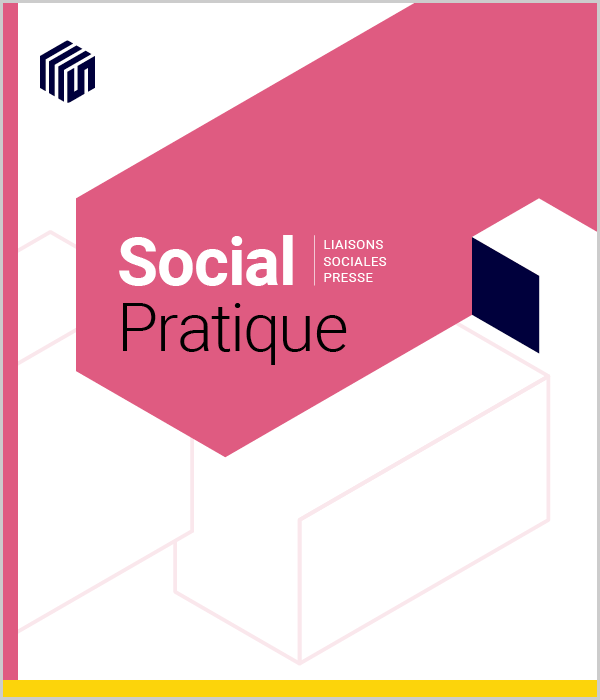Le contrat à durée déterminée (CDD) : guide complet
D'après l'article L.1242-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat de travail temporaire. Il est régi par le droit du travail pour minimiser le risque de dérives. L'employeur ne peut l'utiliser que dans certaines situations que nous allons explorer dans cet article.
Le CDD octroie à l’employeur une certaine liberté d’action. Il peut embaucher un salarié sur une durée déterminée en fonction de la réalité du terrain. Un peu comme une variable d’ajustement. Du côté de l’employé, il offre certaines opportunités de travail sans forcément un engagement à long terme. En dépit de ces qualités, le CDD montre aussi des limites. La question de la stabilité se pose évidemment.
Entrons maintenant dans le cœur du sujet pour comprendre le CDD.
- Le CDD est un contrat temporaire utilisé pour des besoins précis ;
- Il existe différents types de CDD : remplacement, saisonnier, usage et objet défini ;
- Le CDD, renouvelable deux fois, a une durée limitée de 18 mois ;
- Le CDD accorde des droits au salarié : salaire équivalent à un CDI, indemnité de précarité, chômage ;
- La rupture du CDD n’est légale que dans certains cas spécifiques.


Qu’est-ce que le CDD ?
Définition
Le CDD est un contrat de travail qui est conclu pour une période bien définie, délimitée dans le temps. Son but est donc de répondre à un besoin provisoire. Le contrat à durée indéterminée (CDI), quant à lui, est, comme son nom l’indique, prévu pour une durée dite « indéterminée ». La date de fin n'est donc pas précisée.
Pour contrecarrer les abus potentiels, le recours au CDD obéit à des règles précises qui sont régies par le Code du travail.
Principes et caractéristiques du CDD
- Durée du contrat limitée : le CDD prend fin à une date fixée dans le contrat ;
- Motif obligatoire : une justification légale est nécessaire. L’employeur doit motiver sa décision d’embaucher pour une tâche précise comme répondre à l'accroissement temporaire de l'activité ;
- Rémunération équivalente : le salarié en CDD doit avoir une paye au moins égale à celle d’un autre employé qui occuperait le même poste en CDI ;
- Prime de précarité : habituellement et sauf exceptions, l’instabilité induite par la nature du contrat est compensée par une indemnité.
Les différents types de CDD
Le CDD peut en réalité prendre plusieurs formes :
CDD de remplacement
Lorsqu’un salarié en CDI est absent, l’employeur peut opter pour un contrat CDD. Parmi les cas les plus communs, on retrouve notamment :
- Maladie ou accident ;
- Congé maternité ou parental ;
- Formation ;
- Congé sabbatique ;
- Suspension du CDI (mise à pied…).
CDD saisonnier
Le contrat saisonnier est utilisé pour faire face à des pics d’activité limités dans le temps mais réguliers. On parle de caractère saisonnier. Typiquement, qui est concerné ? On retrouve, entre autres, les secteurs suivants :
- Le tourisme (stations de ski, hôtellerie…) ;
- L’agriculture (périodes de récoltes) ;
- Évènements sportifs ou culturels qui induisent un pic d’activité.
CDD d’usage
Le CDD d’usage concerne les cas où l’activité de l’entreprise est discontinue. Par exemple, le marché de l’audiovisuel implique que les salariés ne travaillent pas tout au long de l’année.
Autres types de CDD
Ici, mentionnons brièvement le CDD d’insertion, CDD de professionnalisation et le CDD à objet défini. Le premier est prévu pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en difficulté. Le second permet d’alterner la formation et le travail via un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Le troisième correspond à une mission précise, pour un projet x ou y par exemple.
Les conditions de recours au CDD
Situations autorisées
Un employeur peut recourir au CDD pour :
- Remplacer un salarié absent ;
- Faire face à un pic d’activité temporaire ;
- Un emploi saisonnier ;
- Un emploi d’usage ;
- Un contrat à objet défini.
Interdictions et/ou limitations
- Pas de CDD pour un besoin permanent ;
- Limitation du nombre de CDD successifs.
Sanctions éventuelles
Si le salarié saisit la justice pour cause de renouvellements excessifs du CDD, alors il peut y avoir requalification du CDD en CDI par le tribunal des Prud’hommes. Dans certains cas, l’employeur risque une sanction financière.
Les mentions obligatoires du CDD
D’après l’article L1242-12 du Code du travail, le CDD doit comporter les mentions suivantes.
- L’identité des parties ;
- Le motif précis du recours au CDD ;
- La date de début et la date de fin ;
- L’intitulé du poste occupé et les missions assignées ;
- Le montant de la rémunération ;
- La durée de la période d’essai (si elle est prévue) ;
- Les conditions de renouvellement (si applicable) ;
- La convention collective applicable.
La durée du CDD
Le CDD doit respecter une durée minimale et une durée maximale (voir notre article sur la durée maximale d'un CDD).
Durée minimale et maximale
- CDD classique : 18 mois, renouvellement inclus (article L.1242-8-1 du Code du travail) ;
- CDD de remplacement : jusqu’au retour du salarié remplacé ;
- CDD saisonnier : durée de la saison ;
- CDD d’usage : dépend du secteur ;
- CDD à objet défini : 36 mois maximum.
Gardez en tête que le CDD peut durer jusqu’à 24 mois pour une mission à l’étranger.
Possibilité de renouvellement
En principe, un CDD peut être renouvelé deux fois, sous certaines conditions :
- La durée totale (avec renouvellements) ne doit pas dépasser la limite légale ;
- Le renouvellement d'un CDD doit être prévu par le contrat initial (ou par un avenant signé).
Cas des contrats CDD successifs
Par principe, l’employeur ne peut pas faire succéder deux CDD à la suite sans respecter ce qu’on appelle un délai de carence. Quelle est la durée de ce délai ? 1/3 du temps du contrat initial ou la moitié pour les contrats de moins de 14 jours.
Exceptions :
- CDD de remplacement successifs : pour le remplacement d’un salarié, il n’y a pas de délai de carence à respecter ;
- Si le salarié en CDD change de poste à chaque fois, le délai de carence n’est pas obligatoire.
Quoi qu’il en soit, la volonté du législateur est que le CDD ne doit pas être utilisé ad vitam aeternam. Sinon, le CDD pourra être requalifié en CDI.
La rémunération et les droits des salariés en CDD
Un employé en CDD a les mêmes droits et avantages qu’un salarié en CDI occupant le même poste et les mêmes fonctions.
Salaire et primes
L'égalité des salaires
La rémunération d’un salarié en CDD ne peut être inférieure à celle d’un CDI sur un poste équivalent. Il a d’ailleurs droit aux mêmes avantages (13ème mois, prime de performance, tickets restaurants…).
L'indemnité de précarité
Hors contrats saisonniers et CDD requalifiés en CDI, le salarié en CDD perçoit une indemnité de fin de mission : l’indemnité de précarité. Elle s’élève à 10% de la rémunération brute totale liée au contrat, comme le prévoit l’article L1243-8 du Code du travail.
L'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié en CDD a droit à 5 semaines de congés payés par an. S’il n’a pas pris tous ces congés, il a le droit de toucher une indemnité compensatrice de congés payés. Celle-ci vaut 10% de la rémunération brute totale.
Droits et protection sociale du salarié en CDD
Le salarié en CDD a des droits sociaux. Notamment :
- Le droit aux congés payés ;
- Une mutuelle d’entreprise si elle est obligatoire dans l’entreprise ;
- La formation continue et VAE (validation des acquis de l’expérience).
- Le droit aux indemnités chômage si le salarié peut justifier auprès de Pôle Emploi de certaines conditions comme une durée minimale de travail.
Par ailleurs, il a le droit de bénéficier du :
- Compte personnel de formation (CPF), pour financer son parcours de formation ;
- Conseil en évolution professionnelle (CEP), aide gratuite pour définir son projet ;
- Aides de Pôle emploi (soutien à la création d’entreprise).
La rupture du CDD
Le principe est que le CDD ne peut pas être rompu librement avant son terme, sauf cas particuliers prévus par la loi (article L1243-1 du Code du travail). Ainsi, notons que la démission du CDD n’existe pas en tant que tel, contrairement à la démission du CDI.
Fin "normale" du CDD
La fin "normale" du CDD correspond au dernier jour de travail du salarié stipulé dans le contrat. Le salarié reçoit donc son dernier salaire, son indemnité de précarité et son indemnité compensatrice de congés payés. L’employeur lui fournit aussi l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail.
Rupture anticipée du CDD
Dans des cas spécifiques, la rupture avant le terme du contrat est autorisée :
L’employeur peut rompre prématurément le contrat en cas de :
- Faute grave du salarié (vol, violence…) : le salarié peut par exemple être licencié pour faute grave s’il a volé l’argent de la caisse ;
- Force majeure (événement qui survient de façon imprévisible et qui empêche l’exécution du contrat) ;
- Embauche en CDI du salarié (accord entre les parties).
Le salarié peut rompre le contrat avant son terme en cas de :
- Embauche en CDI ;
- Rupture conventionnelle entre lui et l’employeur (accord entre les parties) ;
- Force majeure.
Si le salarié rompt prématurément le contrat sans l’un des motifs évoqués, l’employeur pourrait obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi.