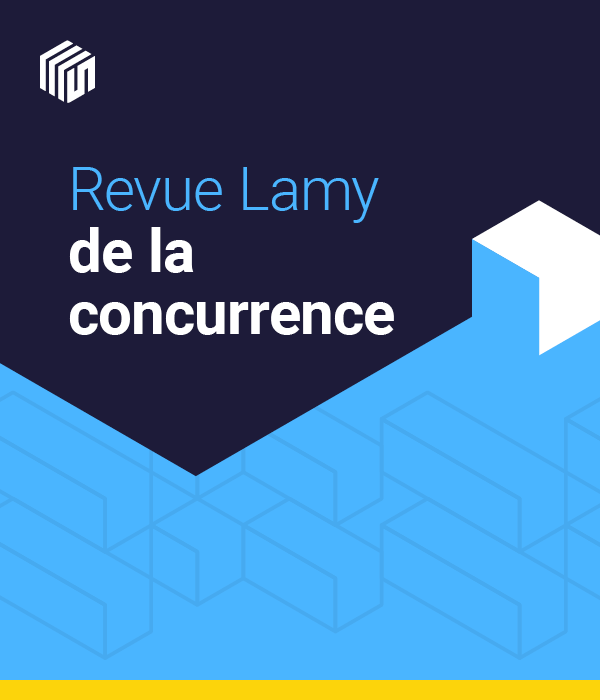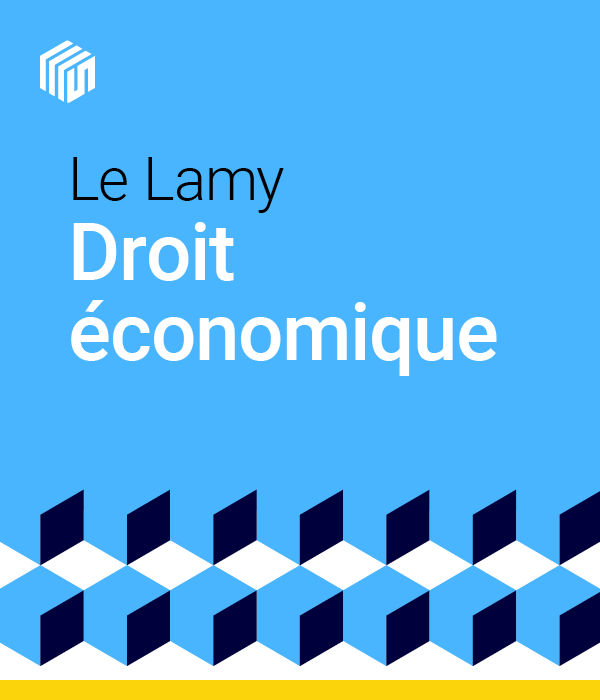Clause de non-concurrence : que dit la loi et comment la rédiger ?
La clause de non-concurrence est présente dans de nombreux contrats de travail, en particulier pour les postes à responsabilité. Son but ? Empêcher un salarié de partir avec le précieux savoir-faire de l’entreprise sous le bras pour le revendre à la concurrence. Mais attention, pour être valable, elle doit respecter un cadre juridique bien précis. Sinon, c’est la porte ouverte aux abus. Avant d’inclure ou de signer une telle clause, mieux vaut être bien informé sur ses tenants et aboutissants. C’est ce que nous allons voir dans cet article, en décryptant les subtilités de la loi et de la jurisprudence.
- La clause de non-concurrence protège l’entreprise en empêchant un ex-salarié de travailler pour un concurrent pendant une durée déterminée.
- Pour être valable, elle doit être indispensable, limitée dans le temps et l’espace, proportionnée et comporter une contrepartie financière.
- On la trouve surtout pour les postes à hautes responsabilités : cadres, ingénieurs, commerciaux ayant accès aux informations stratégiques.
- Le salarié peut contester une clause abusive devant les Prud’hommes pour la faire annuler ou obtenir des dommages et intérêts.
- Qu’est-ce qu’une clause de non-concurrence ?
- Comment fonctionne une clause de non-concurrence ?
- Dans quels types de contrats trouve-t-on cette clause ?
- La validité juridique d’une clause de non-concurrence
- Avantages et inconvénients de la clause de non-concurrence
- Comment rédiger une clause de non-concurrence efficace ?
- Comment contester une clause de non-concurrence abusive ?
Qu’est-ce qu’une clause de non-concurrence ?
Une clause de non-concurrence est concrètement une disposition contractuelle qui figure dans un contrat de travail ou parfois dans une convention collective.
Imaginez que vous êtes ingénieur chez Airbus et que vous décidez de démissionner pour aller travailler chez Boeing. Ou que vous êtes responsable commercial dans une start-up et que vous montez une entreprise dans le même secteur. C’est là que la clause de non-concurrence entre en scène.
Elle vous interdit, pendant un certain temps et sur un territoire donné, d’exercer une activité qui pourrait concurrencer directement votre ancien employeur. L’idée est d’éviter que vous utilisiez à ses dépens tout ce que vous avez appris en travaillant pour lui :
- Les secrets de fabrication,
- Les méthodes commerciales,
- Les données sur les clients,
- etc.
En clair, tout ce qui fait la valeur ajoutée et la compétitivité de l’entreprise. Cela signifie que vous allez devoir soit changer de secteur d’activité, soit vous éloigner géographiquement, le temps que la clause s’applique. Attention à ne pas confondre avec la clause d’exclusivité, qui interdit au salarié toute autre activité professionnelle pendant son contrat.


Comment fonctionne une clause de non-concurrence ?
Rédiger une clause de non-concurrence n’est pas simple. Il faut trouver le juste équilibre. D’une part, la protection légitime des intérêts de l’entreprise. Et d’autre part, le droit du salarié à travailler et à évoluer professionnellement.
Les critères de validité d’une clause
Sur ce point, les juges ont fixé des critères précis. Pour qu’une clause soit valable, il faut qu’elle coche plusieurs cases :
- Indispensable pour protéger les intérêts de l’entreprise. On ne peut pas interdire à un salarié d’aller voir ailleurs juste par principe. Il faut démontrer un risque réel et sérieux de concurrence déloyale (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.135).
- Limitée dans le temps. En général, on tourne autour de 6 mois à 2 ans, selon le poste occupé. Au-delà, c’est trop contraignant pour le salarié.
- Circonscrite à une zone géographique, où il y a effectivement un risque de concurrence. Impossible d’interdire à un commercial de travailler dans toute la France s’il n’était en charge que de trois départements.
- Proportionnée aux fonctions du salarié. Plus il a de responsabilités et accès à des infos sensibles, plus la clause peut être étendue. Mais elle ne doit jamais l’empêcher totalement de trouver un autre emploi.
- Assortie d’une compensation financière. Une clause de non-concurrence se paie. Le salarié doit percevoir une indemnité, en échange de sa mise au placard temporaire (Cass. soc., 15 nov. 2006, n° 04-46.721)
Toutes ces conditions sont cumulatives. S’il en manque une seule, la clause peut être annulée.
La durée et la portée géographique de la clause
C’est l’une des principales pierres d’achoppement des clauses de non-concurrence : elles ne doivent pas durer trop longtemps, ni couvrir un territoire trop vaste. Mais alors, où placer le curseur ?
La jurisprudence donne quelques repères :
- Pour un cadre supérieur, une clause de 2 ans maximum semble être la norme.
- Pour un cadre intermédiaire ou un technicien qualifié, on sera plus proche de 1 an.
- Pour un commercial, entre 6 mois et 1 an paraît raisonnable, sauf situation très spécifique.
Pareil pour la zone géographique d’interdiction. Le plus souvent, la clause se limite à une région, un département, voire à une agglomération pour les activités très localisées. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne peut pas empêcher quelqu’un d’exercer son métier sur tout le territoire national, sauf à lui verser une compensation très importante.
La contrepartie financière de la clause
La loi est claire : pour être valable, la clause doit obligatoirement prévoir une indemnité compensatrice versée au salarié après son départ (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.135).
Son montant n’est pas fixé dans le marbre, mais la jurisprudence considère qu’en dessous de 30% de la rémunération antérieure, cela fragilise la clause (Cass. soc., 15 nov. 2006, n° 04-46.721). Certaines conventions collectives sont plus généreuses, comme celle des ingénieurs et cadres qui table sur 50% minimum.
Exemple :
Dans quels types de contrats trouve-t-on cette clause ?
La clause de non-concurrence n’est pas réservée à une catégorie particulière de contrats. Elle a sa place dans tous les contrats à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou partiel. Même les contrats de professionnalisation ou d’apprentissage peuvent en contenir une.
Seuls les VRP, journalistes, avocats, salariés et mannequins bénéficient de dispositions légales spécifiques qui encadrent plus strictement ces clauses.
Dans la pratique, on les retrouve surtout dans les contrats de travail des professions intellectuelles supérieures, des chercheurs et des commerciaux. Tous les profils qui ont accès à des données ultra-sensibles et qui pourraient facilement les valoriser chez un concurrent :
- Un ingénieur en R&D
- Un directeur financier
- Un chirurgien
- Un consultant
- etc.
La validité juridique d’une clause de non-concurrence
Lorsqu’une clause est attaquée en justice, il y a deux issues. Soit, elle est considérée comme valide, soit elle est réputée nulle. Le salarié peut alors s’en affranchir sans risque. Il peut aussi attaquer l’employeur pour avoir inséré une clause illicite dans son contrat, et lui réclamer des dommages et intérêts.
Les conditions sine qua non posées par la jurisprudence
Pour être parfaitement légale, une clause doit respecter cinq conditions cumulatives (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.135) :
- Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
- Être limitée dans le temps (entre 6 mois et 2 ans selon le poste)
- Être limitée dans l’espace (zone géographique raisonnable et pertinente)
- Tenir compte des spécificités de l’emploi occupé sans interdire toute reconversion
- Comporter une contrepartie financière obligatoire (> 30% du salaire antérieur)
Si l’une de ces cases n’est pas cochée, la clause est considérée comme nulle.
Clauses abusives ou invalides : les pièges à éviter
Les juges n’hésitent pas à les déclarer nulles quand elles sont disproportionnées. Ainsi, les clauses suivantes sont sanctionnées quasi-automatiquement :
- Trop floues : volontairement nébuleuses du type “le salarié s’interdit d’exercer une activité similaire à celle de l’entreprise”. Il faut être précis sur les fonctions et secteurs concernés.
- Trop étendues géographiquement par rapport au poste du salarié : on ne peut pas interdire à un VRP du Cantal d’aller travailler sur toute la France.
- Trop longues pour le métier exercé : 2 ans, cela peut être justifié pour un DRH, beaucoup moins pour un développeur web junior qui a écourté sa période d’essai.
- Imposées à un salarié qui n’a pas vraiment les moyens de faire concurrence : par exemple, une clause de 2 ans pour une secrétaire administrative ou un stagiaire diplômé.
- Prévoyant une indemnité dérisoire : voire pas d’indemnité du tout. Ou, plus créatives, les clauses qui fixent une contrepartie en fonction des gains du salarié chez le concurrent.
Sanctions en cas de violation de la clause
Si le salarié ne la respecte pas après sa démission ou sa rupture conventionnelle, l’employeur peut lui réclamer des dommages et intérêts (une somme d’argent) pour compenser son préjudice. Il peut aussi lui demander de rembourser les indemnités déjà versées et saisir un juge pour le forcer à arrêter son activité concurrente.
À l’inverse, si l’employeur ne paie pas les indemnités prévues, le salarié n’est plus obligé de respecter la clause. Il peut saisir les prud’hommes pour réclamer son dû et des dommages et intérêts en plus.
Enfin, l’employeur peut toujours renoncer à faire jouer la clause, mais il doit le notifier sans tarder, au maximum 1 mois après le départ du salarié (Cass. soc., 13 juin 2007, n° 04-42.740). Sinon, c’est trop tard, la loi considère qu’il souhaite que la clause s’applique.
Avantages et inconvénients de la clause de non-concurrence
Un bouclier efficace pour protéger les atouts de l’entreprise
Vu de l’employeur, la clause de non-concurrence permet de sécuriser le capital immatériel de l’entreprise, qui est souvent son actif le plus précieux :
- Son savoir-faire technique et commercial, fruit de longs mois de R&D et d’expérience terrain.
- Ses données confidentielles, comme la liste des clients, les études de marché, les business plans.
- Sa réputation et son image de marque, bâties par exemple sur la qualité de service.
- Ses méthodes de travail et process internes, façonnés sur mesure pour optimiser la production.
Un frein à la liberté professionnelle des salariés
Côté salarié, la clause est synonyme de contraintes. Cela signifie que pendant X mois, on n’aura pas le droit de travailler dans son domaine de compétence. Pour un cadre spécialisé, un chercheur pointu ou un commercial avec un carnet d’adresses, cela représente un réel handicap.
Sans compter que l’indemnité de non-concurrence est souvent loin de compenser intégralement la perte de salaire. Avec 30% à 50% du dernier salaire fixe, cela est difficilement tenable. Au final, on y perd souvent au change financièrement.
Comment rédiger une clause de non-concurrence efficace ?
Il faut trouver le juste milieu. Assez dissuasif pour éviter la concurrence déloyale, mais pas trop punitif pour éviter que la clause soit invalidée. L’exercice n’est pas simple.
Exemples de clauses qui tiennent la route
Voici un exemple de clause valide. Les activités interdites sont clairement identifiées, la zone géographique et la durée d’application sont raisonnables, la contrepartie financière est conséquente et les sanctions sont prévues :
“Compte tenu de la spécificité de ses fonctions au sein de la société X et des informations confidentielles auxquelles il aura accès, M. Y s’interdit d’exercer, en cas de rupture du présent contrat, toute activité concurrente.
Cette interdiction porte sur le secteur de la [vous décrivez précisément le domaine] et s’applique aux entreprises suivantes [la liste complète] dans un rayon de [X] km autour de [la ville].
Elle vaut pour une durée de [X] mois à compter du départ effectif de M. Y de la société X. En contrepartie, M. Y percevra pendant toute la période d’interdiction une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle brute de [X] €, soit [X]% de sa rémunération moyenne des [X] derniers mois.
Toute violation de cet engagement par M. Y l’exposerait à des dommages et intérêts correspondants au préjudice subi, outre le remboursement des sommes versées au titre de la contrepartie pécuniaire.”
Exemples de clauses qui tiennent la route
Voici un exemple de clause valide. Les activités interdites sont clairement identifiées, la zone géographique et la durée d’application sont raisonnables, la contrepartie financière est conséquente et les sanctions sont prévues :
“Compte tenu de la spécificité de ses fonctions au sein de la société X et des informations confidentielles auxquelles il aura accès, M. Y s’interdit d’exercer, en cas de rupture du présent contrat, toute activité concurrente.
Cette interdiction porte sur le secteur de la [vous décrivez précisément le domaine] et s’applique aux entreprises suivantes [la liste complète] dans un rayon de [X] km autour de [la ville].
Elle vaut pour une durée de [X] mois à compter du départ effectif de M. Y de la société X. En contrepartie, M. Y percevra pendant toute la période d’interdiction une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle brute de [X] €, soit [X]% de sa rémunération moyenne des [X] derniers mois.
Toute violation de cet engagement par M. Y l’exposerait à des dommages et intérêts correspondants au préjudice subi, outre le remboursement des sommes versées au titre de la contrepartie pécuniaire.”
Les bonnes pratiques pour sécuriser sa clause
Pour avoir une clause de non-concurrence solide, voici quelques conseils pratiques :
Côté employeur :
- Adaptez le périmètre d’interdiction aux fonctions concrètes du salarié. Inutile de prévoir une clause contraignante s’il n’est pas en contact avec des informations ultra-sensibles.
- Fixez une durée et une zone géographique proportionnées à l’impact potentiel d’une concurrence.
- Prévoyez une contrepartie financière attractive, au moins 30% du brut. Plus c’est indolore pour le salarié, mieux c’est.
- Mentionnez la faculté de renonciation pour ne pas vous retrouver pieds et poings liés si la situation évolue.
- Faites signer la clause dès le recrutement. Cela évitera les mauvaises surprises au départ.
Côté salarié :
- Vérifiez que la clause est justifiée au regard de vos missions réelles. Si elle est passe-partout, c’est un point d’alerte.
- Négociez un champ d’application réduit, autant que possible. Chaque mois de moins et chaque kilomètre gagné sont bons à prendre.
- Poussez pour une indemnisation généreuse, notamment si vous êtes bien placé pour rebondir vite ailleurs.
- Faites spécifier noir sur blanc les cas de dispense (licenciement économique, faute grave de l’employeur, par exemple).
- Exigez une notification rapide de la volonté d’application de la clause. Au-delà d’un mois, c’est un point d’alerte.
En cas de doute, n’hésitez pas à faire relire votre clause par un avocat en droit social. Il pourra repérer les failles et vous aider à renégocier les termes en votre faveur.
Comment contester une clause de non-concurrence abusive ?
Si vous estimez que votre clause de non-concurrence est excessive ou illégale, vous pouvez la contester devant le Conseil de prud’hommes. Cela dit, le mieux reste d’anticiper avant de signer.
Les recours possibles en cas d’abus
Vous vous rendez compte que votre clause de non-concurrence ne respecte pas les critères de validité ? Par exemple si elle est floue, trop longue, pas limitée géographiquement ou sans vraie contrepartie. Vous pouvez la contester devant le Conseil de prud’hommes pour :
- Faire annuler la clause si elle ne respecte pas les conditions de validité (imprécise, durée excessive, absence de contrepartie financière, etc.).
- Obtenir des dommages et intérêts si la clause est abusive et vous cause un préjudice (perte de revenus, frais de reconversion, etc.).
Autre cas de figure : votre ex-employeur exige l’application de la clause mais “oublie” de vous verser les indemnités prévues. Vous pouvez alors le mettre en demeure, passer outre l’interdiction et travailler dans votre secteur.
La négociation avant la signature du contrat
Cependant, mieux vaut être vigilant avant de signer la clause, qui doit être négociée comme le reste du contrat :
- Demandez à l’employeur de justifier la nécessité de la clause.
- Faites-lui préciser les activités réellement concurrentes.
- Négociez la durée, le périmètre géographique et le montant de la contrepartie financière.
- Prévoyez les cas de renonciation automatique (licenciement, rupture conventionnelle).
- Fixez un délai pour que l’employeur confirme l’application de la clause après le départ.
En cas de désaccord persistant, mieux vaut parfois renoncer à un emploi que de s’engager dans des conditions défavorables.
FAQ
Toutes les réponses aux questions que vous vous posez.